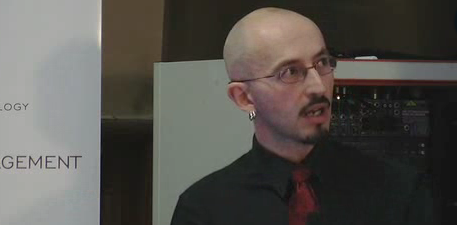Tag: réseaux sociaux

La guerre du copyright. Podcast d’Antonio Casilli (France Culture, La Grande Table, 08 févr. 2012)
Podcast de La Grande Table, le magazine culturel de la mi-journée sur France Culture, consacré à l’affaire Megaupload et à la guerre du copyright. Pour en parler avec Caroline Broué, les historiens Pascal Ory et André Gunthert et le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil)…

Au séminaire Médiacultures (LCP CNRS, Paris, 6 févr. 2012)
Le sociologue Antonio A. Casilli intervient pour parler de son ouvrage Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil), dans le cadre du séminaire Médiacultures et Régimes de valeur culturels du Laboratoire ‘Communication et Politique’ du CNRS…

Au séminaire de l'IXXI "Réseaux et mouvements sociaux" (ENS Lyon, 3 févr. 2012)
Le sociologue Antonio A. Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil), intervient pour parler du rôle des médias sociaux dans les révolutions arabes et dans les émeutes britanniques de 2011 dans le cadre du séminaire Réseaux et mouvements sociaux de l’IXXI, Institut Rhône-Alpes des Systèmes Complexes…

"Social media to counter academic proletarization" : tribune d'Antonio Casilli dans LSE Impact of Social Sciences Blog (Royaume-Uni, 25 jan. 2012)
Le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques (Seuil), est l’invité de Impact of Social Sciences de la London School of Economics. Le prestigieux blog anglais héberge une tribune sur le rôle des médias sociaux et des TIC pour contrecarrer le processus de prolétarisation des professions scientifiques qui touche tout particulièrement les sciences sociales.

"Privacy e relazioni digitali" : podcast d'Antonio Casilli (Radio Città Fujiko, Italie, 23 janv. 2012)
Sur Radio Città Fujiko, l’une des plus anciennes “radio libere” italiennes, le journaliste Alessio Aimone interviewe le sociologue Antonio Casilli, autour de son livre Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil). Vie privée, corps en ligne, politique : comment Internet reconfigure notre manière de faire société…

De la contagion médicale à la viralité informatique. Podcast d'Antonio Casilli (France Culture, La Grande Table, 20 janv 2012)
Podcast de La Grande Table, le magazine culturel de la mi-journée sur France Culture, consacré à la notion de contagion. Pour en parler avec Caroline Broué autour du numéro 21 de la revue de sciences humaine Tracés, les philosophes Michael Foessel et Mathieu Potte-Bonneville et le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil)…

Privacy en ligne : podcast d'Antonio A. Casilli (France Culture, La Grande Table, 5 janv. 2012)
Podcast de La Grande Table, le magazine culturel de la mi-journée sur France Culture, consacré à la vie privée en ligne. Pour en parler avec Caroline Broué autour du livre de Jeff Jarvis Public parts, l’historien André Gunthert, le journaliste Philippe Trétiack et le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil)…

"Surveillance participative et vie privée en réseau" : présentation d'Antonio Casilli au colloque Internet y el futuro de la democracia (Espagne, 20 déc. 2011)
Le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil), interviendra au colloque international “Internet y el futuro de la democracia”. Organisé par l’Institut pour la Gouvernance Démocratique Globernance, le colloque aura lieu au Parlement Basque (Vitoria-Gasteiz) le 19 et 20 décembre 2011.
Vidéo de l’intervention d’Antonio Casilli, Chaire de Recherche Réseaux Sociaux (29 nov. 2011)
Vidéo de la présentation “Mesures : métriques, diffusion virale de l’information et de l’e-reputation” du sociologue Antonio A. Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil), à l’occasion de l’inauguration de la première chaire de recherche française sur les réseaux sociaux. L’événement s’est déroulé le 29 novembre 2011, à Télécom ParisTech, Paris.

Les émeutes de Londres et les digital humanities (Homo numéricus, 28 août – 9 septembre 2011)
Dans le blog Homo Numéricus, Pierre Mounier consacre deux billets (1/2 et 2/2) aux liens entre humanités numériques et la récente étude sur les émeutes de Londres signée par Paola Tubaro et Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil). L’usage de méthodes computationnelles peut aider à réconcilier recherche et demande sociale – à condition de ne pas verser dans le fétichisme de l’outil informatique. “Antonio Casilli et Paola Tubaro mobilisent à la fois un modèle théorique et un outil de simulation sur ordinateur pour tester la proposition de Cameron : les réseaux sociaux ont amplifié les émeutes, couper les communications permettra de réduire l’ampleur de futures émeutes…”