Month: March 2017
![[Vidéo] Digital labor : le syndicalisme qui vient (Paris, 29 mars 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/05/logo-cgt-grand-1038x576.png)
[Vidéo] Digital labor : le syndicalisme qui vient (Paris, 29 mars 2017)
Le 29 mars 2017, j’étais l’invité du syndicat Ugict-CGT pour une soirée débat autour de la thématique de l’uberisation, et… read more [Vidéo] Digital labor : le syndicalisme qui vient (Paris, 29 mars 2017)

Marché du travail : entre automation et modèles pré-capitalistes (Alternatives Economiques, 28 mars 2017)
Dans le magazine Alternatives Economiques, Franck Aggeri, professeur de management à Mines ParisTech, fournit une analyse en quatre temps de… read more Marché du travail : entre automation et modèles pré-capitalistes (Alternatives Economiques, 28 mars 2017)
![[Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/03/DataAIsuggest.jpg)
[Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)
Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Pour la séance du 10 avril 2017 EHESS… read more [Séminaire #ecnEHESS] Mary L. Gray “Amazon MTurk: les coulisses de l’intelligence artificielle” (10 avril 2017, 17h)

Qui entraîne les IA et les drones ? Les internautes (Le Figaro, 22 mars 2017)
Dans Le Figaro no. 22586, en kiosque le mercredi 22 mars 2017, un article sur les liens entre digital labor… read more Qui entraîne les IA et les drones ? Les internautes (Le Figaro, 22 mars 2017)

Le micro-travail : des corvées peu gratifiantes et mal rémunérées (01net, 22 mars 2017)
Dans le magazine 01net du 22 mars 2017, une longue enquête sur les marchés du micro-travail du Sud Global, avec… read more Le micro-travail : des corvées peu gratifiantes et mal rémunérées (01net, 22 mars 2017)

Inscrire dans le Code du travail le digital labor (Slate, 19 mars 2017)
Le média d’information Slate a demandé à 100 chercheurs des proposition pour la campagne présidentielle 2017. Da la médecine, à… read more Inscrire dans le Code du travail le digital labor (Slate, 19 mars 2017)

Ailleurs dans les médias (janv.-mars 2017)
» (24 mars 2017) Turc mécanique d’Amazon, comment les travailleurs du clic sont devenus esclaves de la machine, Cnet »… read more Ailleurs dans les médias (janv.-mars 2017)
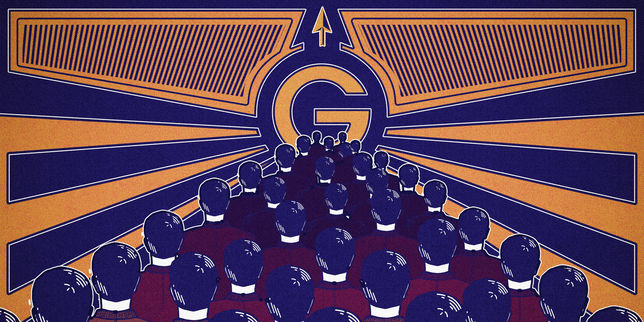
Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)
Le quotidien Le Monde démarre une enquête sur le digital labor. Le coup d’envoi ? Cette interview que j’ai accordée… read more Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)
![[Séminaire #ecnEHESS] Nikos Smyrnaios “Les GAFAM : notre oligopole quotidien” (20 mars 2017, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/03/dislike.png)
[Séminaire #ecnEHESS] Nikos Smyrnaios “Les GAFAM : notre oligopole quotidien” (20 mars 2017, 17h)
Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Dans le cadre de notre séminaire EHESS Etudier… read more [Séminaire #ecnEHESS] Nikos Smyrnaios “Les GAFAM : notre oligopole quotidien” (20 mars 2017, 17h)