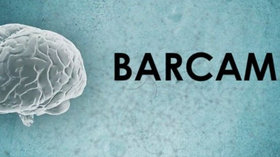Tag: enseignement

Comment enseigner à l’heure de ChatGPT (Le Parisien, 22 févr. 2023)
Dans le quotidien Le Parisien, la journaliste Claire Barthelemy relate d’une expérience que j’ai conduit dans le cadre de mon… read more Comment enseigner à l’heure de ChatGPT (Le Parisien, 22 févr. 2023)
![[Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/11/clickfarm.png)
[Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)
Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Pour la première séance de l’édition 2017/18 de… read more [Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)
![[Slides #ecnEHESS] Le digital labor par le prisme des émotions (Camille Alloing et Julien Pierre, 4 avr. 2016, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/03/moji2.jpg)
[Slides #ecnEHESS] Le digital labor par le prisme des émotions (Camille Alloing et Julien Pierre, 4 avr. 2016, 17h)
Pour la séance du 4 avril 2016 de mon séminaire EHESS Etudier le cultures du numérique, nous avons eu le… read more [Slides #ecnEHESS] Le digital labor par le prisme des émotions (Camille Alloing et Julien Pierre, 4 avr. 2016, 17h)
"Les sciences sociales et les TIC" : un essai d'Antonio Casilli dans Read/Write Book 2 (2012)
Le deuxième volume de Read Write Book, ouvrage scientifique dirigé par Pierre Mounier, accueille une contribution d’Antonio Casilli, sociologue et auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Editions du Seuil). Le texte, transcription de la conférence donnée par l’auteur dans le cadre de la journée internationale de rencontres Sciences sociales 2.0 (ENS Lyon, 17 novembre 2011), est disponible gratuitement en ligne sur le site de l’éditeur.
Quatre vidéos d’Antonio A. Casilli au Barcamp "Médias sociaux dans l’enseignement supérieur" (07 déc. 2011)
Le sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil), ouvrira la deuxième journée du Barcamp 2011 Pratiques de l’Internet participatif et des médias sociaux dans l’Enseignement supérieur, Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), 1 avenue Léon Journault, 92318 Sèvres. L’intervention, ayant pour titre Les médias sociaux, entre nouvelle sociabilité et nouvelle misère en milieu étudiant, aura lieu entre 9h30 et 10h30.