Tag: plateformes
Sur Radio Parleur (15 mai 2020)
Travailleurs, travailleuses du clic, défendez-vous ! – Ceci n’est pas une parenthèse #4 DE VIOLETTE VOLDOIRE15 MAI 20201204 0 L’événement est… read more Sur Radio Parleur (15 mai 2020)
[Podcast] Économie des plateformes et Covid-19 (France Culture, 15 mai 2020)
Avec l’économiste Philippe Askenazy, j’ai participé à l’émission Entendez-vous l’éco (France Culture) dans le cadre d’une semaine consacrée à la… read more [Podcast] Économie des plateformes et Covid-19 (France Culture, 15 mai 2020)
![[Séminaire #ecnEHESS] La start-up nation: un cirque sans filet ? (Silvio Lorusso & Aude Launay, 12 mars 2020, 19h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/03/entreprecariat.png)
[Séminaire #ecnEHESS] La start-up nation: un cirque sans filet ? (Silvio Lorusso & Aude Launay, 12 mars 2020, 19h)
Enseignement ouvert aux auditeurs libres (dans la limite des places disponibles). Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Le prochain… read more [Séminaire #ecnEHESS] La start-up nation: un cirque sans filet ? (Silvio Lorusso & Aude Launay, 12 mars 2020, 19h)

Espaces numériques, travail et idéologie (conférence, La Gaîté Lyrique, 6 nov. 2018)
Le 6 novembre 2018 j’ai eu le plaisir d’intervenir lors de la conférence de lancement du cycle “Idéologies et technologies”,… read more Espaces numériques, travail et idéologie (conférence, La Gaîté Lyrique, 6 nov. 2018)
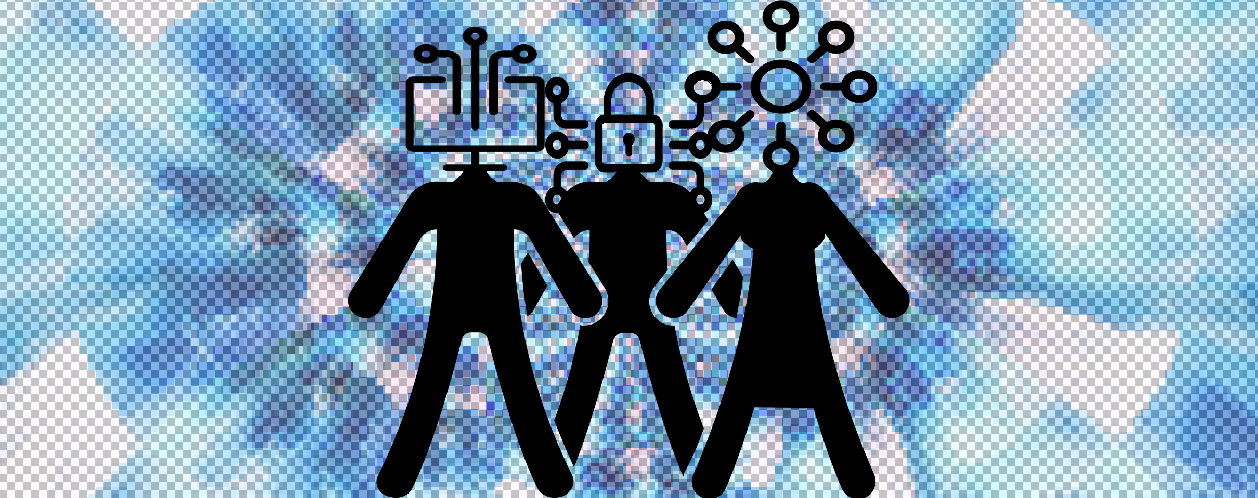
Le programme du séminaire #ecnEHESS 2018/19 est arrivé !
Mon séminaire Étudier les cultures du numérique (mieux connu comme #ecnEHESS) est de retour pour la 11e année consécutive. Structure… read more Le programme du séminaire #ecnEHESS 2018/19 est arrivé !
![[Video] Une théologie politique des plateformes numériques (Québec, Canada, 24 mai 2018)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2018/05/diggers1.jpg)
[Video] Une théologie politique des plateformes numériques (Québec, Canada, 24 mai 2018)
Vidéo de la conférence “De quoi une plateforme numérique est-elle le nom ? Généalogie historique et récupération économique” que j’ai… read more [Video] Une théologie politique des plateformes numériques (Québec, Canada, 24 mai 2018)

Une loi sur les fake news : à quoi bon ? Tribune dans L’Obs (1 mars 2018)
Si la notion de « fausse nouvelle » est déjà définie par la loi sur la liberté de la presse… read more Une loi sur les fake news : à quoi bon ? Tribune dans L’Obs (1 mars 2018)

Pourquoi la vente de nos données personnelles (contre un plat de lentilles) est une très mauvaise idée
Jacob dit : ‘Vends-moi aujourd’hui tes données”. “Voici”, s’exclama Esaü, “je m’en vais mourir de faim ! A quoi me… read more Pourquoi la vente de nos données personnelles (contre un plat de lentilles) est une très mauvaise idée

Pagina99 (Italie, 16 juin 2017)
Nel quotidiano Pagina99, numero speciale del weekend 17 giugno 2017 “algoritmi e sorveglianza”, una lunga intervista rilasciata al giornalista Samuele… read more Pagina99 (Italie, 16 juin 2017)

Dans Télérama (10 mai 2017)
Dans le numéro de Télérama en kiosque le mercredi 10 mai 2017, une enquête du journaliste Olivier Tesquet sur le… read more Dans Télérama (10 mai 2017)

![[Podcast] Économie des plateformes et Covid-19 (France Culture, 15 mai 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)