Tag: santé
[Vidéo] Biopolitique et coronavirus (La Manufacture d’Idées, 23 août 2020)
Dans le cadre de la manifestation La Manufacture d’Idées dont l’édition 2020 a eu lieu à Hurigny du 21 au… read more [Vidéo] Biopolitique et coronavirus (La Manufacture d’Idées, 23 août 2020)

Compte rendu de “Le Phénomène ‘pro-ana'” dans Le Monde (24 oct. 2016)
“Pourtant, pour les deux chercheurs, contrairement aux idées reçues, «il n’y a pas d’apologie de la maigreur, au contraire. Ces… read more Compte rendu de “Le Phénomène ‘pro-ana’” dans Le Monde (24 oct. 2016)
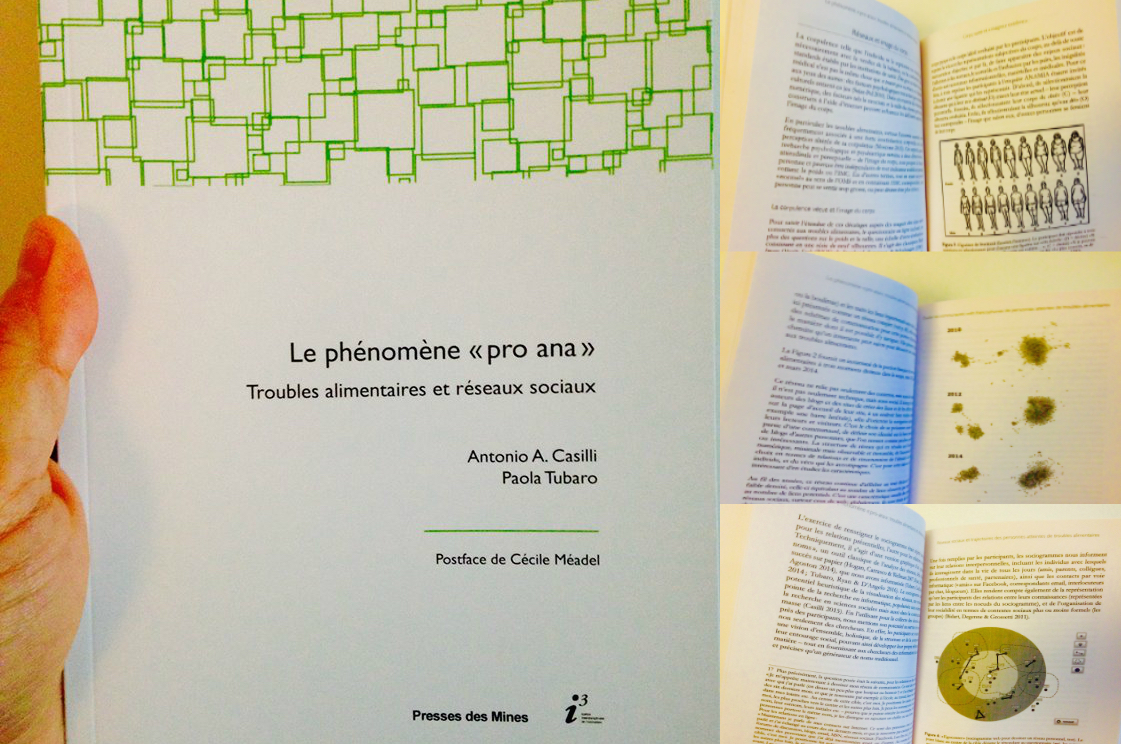
Dernier ouvrage : “Le phénomène “pro-ana’. Troubles alimentaires et réseaux sociaux” (Oct. 2016)
Mon dernier ouvrage (co-écrit avec Paola Tubaro) est Le phénomène “pro-ana”. Troubles alimentaires et réseaux sociaux, paru aux Presses des… read more Dernier ouvrage : “Le phénomène “pro-ana’. Troubles alimentaires et réseaux sociaux” (Oct. 2016)

Arrêtez de vous faire du souci pour la santé mentale de Trump : c’est celle de ses Twitter-ouvriers qui est à risque
Dans sa récente contribution lors du symposium re:publica 2016, Sarah T. Roberts soulignait les risques pour la santé mentale (et… read more Arrêtez de vous faire du souci pour la santé mentale de Trump : c’est celle de ses Twitter-ouvriers qui est à risque

Antonio Casilli invité de Citéphilo (CHRU, Lille, 27 mars 2012)
Le mardi 27 mars de 12h30 à 14h, Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Ed. du Seuil) sera l’invité de Citéphilo pour une conférence sur corps, santé et liens sociaux du Web. L’initiative, en partenariat avec le midi philosophique de la médiathèque de la Cité, sera animée par Jean-Michel Hennebel et aura lieu au CHRU de Lille – Hôpital Claude Huriez, salle Multimédia…

"Usages numériques en santé" : un texte d'Antonio Casilli dans DH Magazine (jan/fév 2012)
Dans le numéro de janvier 2012 de DH Magazine, le texte de l’intervention d’Antonio Casilli, sociologue et auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil) dans le cadre du colloque Euro Cos Humanisme & Santé. Le texte complet est aussi disponible sur HAL Archives Ouvertes…
![[Vidéo] Biopolitique et coronavirus (La Manufacture d’Idées, 23 août 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/manufidées.jpg)