Tag: seuil
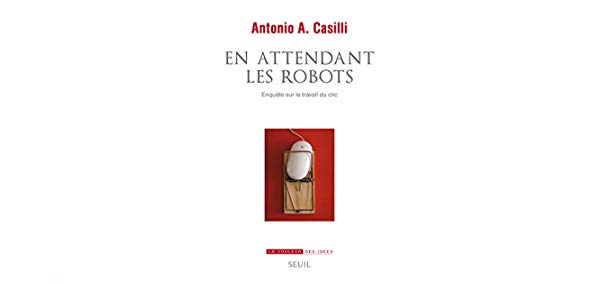
Mon ouvrage «En attendant les robots», Grand Prix de la Protection Sociale 2019
Mon livre En attendant les robots – Enquête sur le travail du clic, paru en janvier 2019 aux Éditions du… read more Mon ouvrage «En attendant les robots», Grand Prix de la Protection Sociale 2019

“Magnifique leçon de lucidité” : une recension de En attendant les robots (Le Monde, 9 janvier 2019)
Après la publication des bonnes feuilles de En attendant les robots (Seuil 2019) le 3 janvier 2019, le 9 janvier… read more “Magnifique leçon de lucidité” : une recension de En attendant les robots (Le Monde, 9 janvier 2019)

Un weekend “En attendant les robots” sur France Culture (5-6 janv. 2019)
A l’occasion de sa parution, France Culture a consacré trois émissions à mon ouvrage En attendant les robots – Enquête… read more Un weekend “En attendant les robots” sur France Culture (5-6 janv. 2019)

Le Monde publie les bonnes feuilles de “En attendant les robots” (3 janv. 2019)
Le jour 3 janvier 2019 Pixels, le supplément numérique du quotidien Le Monde, publie en avant-première des extraits de mon… read more Le Monde publie les bonnes feuilles de “En attendant les robots” (3 janv. 2019)
![[Vidéo] Conférence de lancement de “En attendant les robots” (Musée des Arts et Métiers, 3 janv. 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2018/12/cnamrobots2019.png)
[Vidéo] Conférence de lancement de “En attendant les robots” (Musée des Arts et Métiers, 3 janv. 2019)
Mon nouvel ouvrage En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic (Éditions du Seuil) sortira le 3 janvier 2019. J’ai l’immense plaisir de vous inviter à la soirée de lancement, qui aura lieu à cette date au Musée des Arts et Métiers.

Dans le Blog de l’IMT (4 janv. 2019)
Entretien avec le blog de l’Institut Mines-Telecom, pour reparcourir mon parcours, de mes travaux sur la vie privée et les… read more Dans le Blog de l’IMT (4 janv. 2019)

“En attendant les robots” sélection du mois de La Recherche (janv. 2019)
La Recherche, no. 543, mardi 1 janvier 2019, p. 90 Sélection du mois Sociologie En attendant les robotsGautier Cariou En… read more “En attendant les robots” sélection du mois de La Recherche (janv. 2019)

"Qu’est-ce que la sociologie a à faire avec les ordinateurs ?" : podcast d'Antonio Casilli dans l'Atelier des médias (RFI, 16 oct. 2010)
Ecouter le podcast du sociologue Antonio Casilli, auteur de Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? (Seuil, 2010) interviewé par Ziad Maalouf dans l’émission L’Atelier des médias (RFI, 16 octobre 2010). Dix-sept minutes pour découvrir ensemble les transformations de notre manière de faire société en ligne – et pour comprendre pourquoi les sociologues, initialement sceptiques, ont dû se rende à l’évidence : le Web n’est pas seulement synonyme d’isolement social.
Présentations, actualités, contact presse : comment se servir de ce site
Pour les lecteurs, c’est l’occasion de découvrir les dernières actualités de “Les liaisons numériques” (Seuil, 2010), de rencontrer son auteur au cours de conférences et de présentations. Les étudiants, les enseignants et les chercheurs peuvent télécharger des présentations powerpoint des chapitres, découvrir les autres publications d’Antonio Casilli, ou s’inscrire en auditeurs libres à son séminaire EHESS. Pour les journalistes et pour toute personne intéressée à faire connaître le livre en écrivant une critique ou une présentation, l’Espace presse met à disposition un dossier contentant des renseignements pratiques, des résumés et des images…
![[Video] Interview sur “En attendant les robots” (Institut Français, 1 avr. 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/05/logo_institutfrancais_1.jpg)