Month: September 2019

Interview dans Sciences et Avenir (HS 35, 25 sept. 2019)
« Dans les usines à clic, des millions de petites mains bien humaines » PROPOS RECUEILLIS PAR LOÏC CHAUVEAU L’enrichissement… read more Interview dans Sciences et Avenir (HS 35, 25 sept. 2019)
![[Vidéo] Leçon inaugurale année universitaire, département sociologie, Université de Genève (25 sept. 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/10/poinconneursGeneve.jpg)
[Vidéo] Leçon inaugurale année universitaire, département sociologie, Université de Genève (25 sept. 2019)
La Faculté des sciences de la société et le Département de sociologie de l’Université de Genève m’ont fait l’honneur de… read more [Vidéo] Leçon inaugurale année universitaire, département sociologie, Université de Genève (25 sept. 2019)

Grand entretien dans le 1 Hebdo (25 sept. 2019)
Dans le numéro 265 de l’hebdomadaire Le 1, j’ai accordé un entretien au journaliste Julien Bisson. « Des formes de subordination… read more Grand entretien dans le 1 Hebdo (25 sept. 2019)
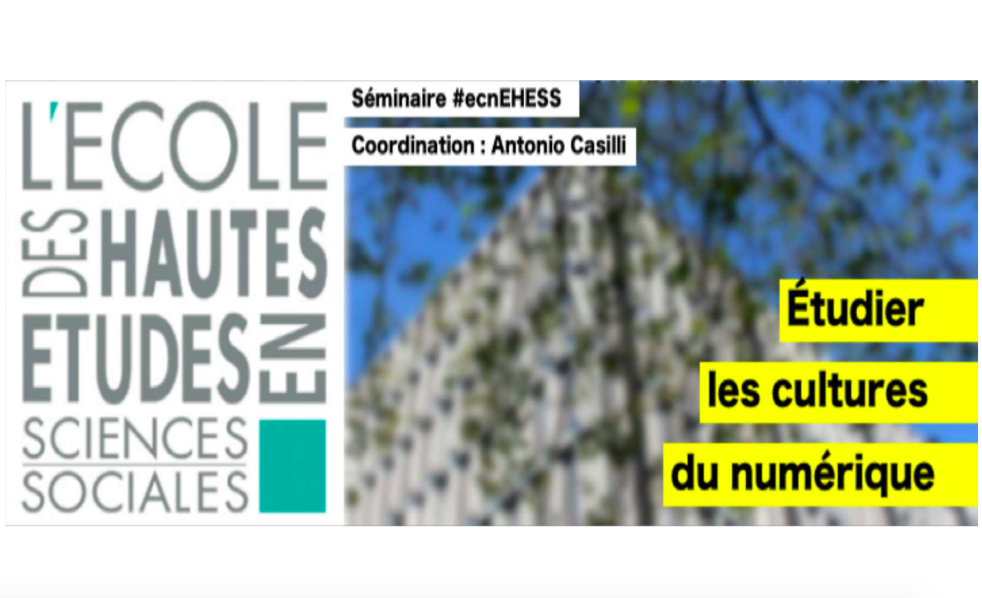
Le programme du séminaire “Étudier les cultures du numérique” (#ecnEHESS) 2019-2020 enfin disponible !
Mon séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique (mieux connu comme #ecnEHESS) est de retour pour la 12e année consécutive… read more Le programme du séminaire “Étudier les cultures du numérique” (#ecnEHESS) 2019-2020 enfin disponible !

Ailleurs dans les médias (sept. – déc. 2019)
(19 déc. 2019) Faut-il un moratoire sur la reconnaissance faciale ?, Digital Society Forum. (7 déc. 2019) L’intelligence artificielle va-t-elle… read more Ailleurs dans les médias (sept. – déc. 2019)
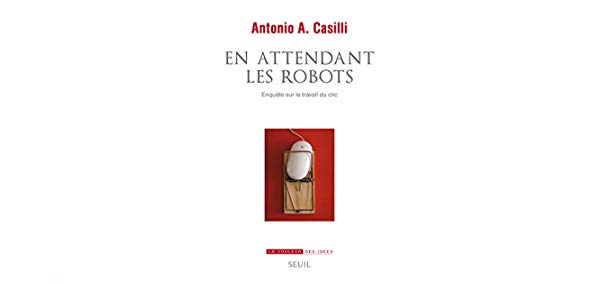
Mon ouvrage «En attendant les robots», Grand Prix de la Protection Sociale 2019
Mon livre En attendant les robots – Enquête sur le travail du clic, paru en janvier 2019 aux Éditions du… read more Mon ouvrage «En attendant les robots», Grand Prix de la Protection Sociale 2019