Month: October 2020
[Podcast] “Miliardi di schiavi del clic”: intervista a Eta Beta [Rai Radio 1, 31 ott. 2020)
Nella trasmissione dedicata alla tecnologia Eta Beta (Rai Radio 1), ho avuto il piacere di essere ospite al microfono di… read more [Podcast] “Miliardi di schiavi del clic”: intervista a Eta Beta [Rai Radio 1, 31 ott. 2020)
[Video] Presentazione del libro “Schiavi del clic” al Nexa Center for Internet & Society (Politecnico di Torino, 23 ott. 2020)
Clicca qui per la presentazione dell’evento. “Schiavi del clic” (Feltrinelli 2020), traduzione italiana di “En attendant les robots” (Seuil 2019, Premio… read more [Video] Presentazione del libro “Schiavi del clic” al Nexa Center for Internet & Society (Politecnico di Torino, 23 ott. 2020)
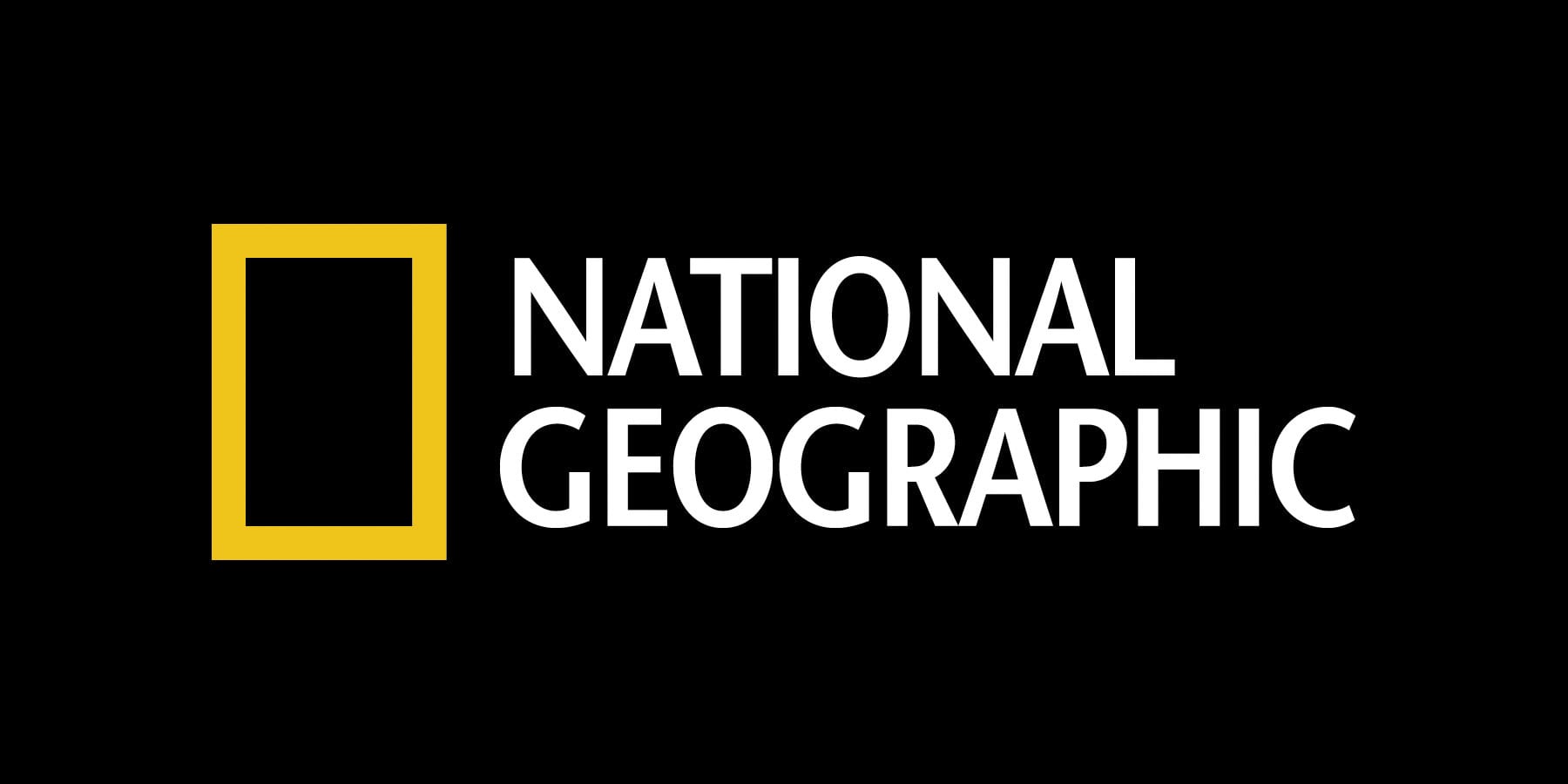
Grand entretien dans le National Geographic (15 oct. 2020)
En entretien avec la journaliste Marie-Amélie Carpio, National Geographic France. Les ouvriers du clic, le prolétariat 2.0 Contrairement à ce… read more Grand entretien dans le National Geographic (15 oct. 2020)
[Vidéo] Intervention colloque “Les SHS à l’heure du Covid-19” (ENS Paris Saclay, 12 oct. 2020)
Présentation du colloque.

Ne Il Sole 24 Ore (11 ott. 2020)
Nel quotidiano Il Sole 24 Ore (rubrica Nòva), un editoriale di Luca De Biase presenta il mio libro Schiavi del… read more Ne Il Sole 24 Ore (11 ott. 2020)

Intervista ne Il Giorno (1 ott. 2020)
Dati e intelligenze artificiali, siamo tutti schiavi dei colossi di internet Non solo fattorini di cibo e pacchi: i cittadini… read more Intervista ne Il Giorno (1 ott. 2020)
![[Podcast] “Miliardi di schiavi del clic”: intervista a Eta Beta [Rai Radio 1, 31 ott. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/RAI-Logo-TV.jpeg)
![[Video] Presentazione del libro “Schiavi del clic” al Nexa Center for Internet & Society (Politecnico di Torino, 23 ott. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/copertina-casilli_0.jpeg)
![[Vidéo] Intervention colloque “Les SHS à l’heure du Covid-19” (ENS Paris Saclay, 12 oct. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/Bandeau-Colloque-SHS-face-au-Covid-19-1-1280x640-1.jpg)