Tag: algorithmes

Mon texte sur l’actualité des luttes abolitionnistes publié dans le magazine Le 1 Hebdo (14 mars 2022)
Le magazine Le 1 Hebdo publie ma tribune sur l’abolitionnisme, entre lutte contre la dissuasion nucléaire et limitation des algorithmes…. read more Mon texte sur l’actualité des luttes abolitionnistes publié dans le magazine Le 1 Hebdo (14 mars 2022)
[Vidéo] [séminaire #ECNEHESS] Angèle Christin (ft. Berlin Tech Workers Coalition) : “De l’éthique à l’ethnographie des algorithmes” (wébinaire, 11 mars 2021, 19h)
La quatrième séance d’approfondissement de notre séminaire #ecnEHESS Étudier les cultures du numérique (organisée en collaboration avec la Gaîté Lyrique) a eu… read more [Vidéo] [séminaire #ECNEHESS] Angèle Christin (ft. Berlin Tech Workers Coalition) : “De l’éthique à l’ethnographie des algorithmes” (wébinaire, 11 mars 2021, 19h)
![Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/Logo_de_Relations.png)
Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]
Par : Emiliano Arpin-Simonetti Dans son dernier ouvrage En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic (Seuil, 2019), Antonio A…. read more Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]

Tribune dans Le Monde (6 févr. 2020)
« L’avènement du dresseur d’intelligences artificielles » Tribune. Face aux inquiétudes autour de l’effacement annoncé du travail humain par une… read more Tribune dans Le Monde (6 févr. 2020)
![[Slides séminaire #ecnEHESS] Plateformes numériques : gouvernementalité algorithmique et libertés (Olivier Ertzscheid)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/12/leviathan.jpg)
[Slides séminaire #ecnEHESS] Plateformes numériques : gouvernementalité algorithmique et libertés (Olivier Ertzscheid)
Dans le cadre du séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique j’ai eu le plaisir d’accueillir Olivier Ertzscheid, maître de… read more [Slides séminaire #ecnEHESS] Plateformes numériques : gouvernementalité algorithmique et libertés (Olivier Ertzscheid)

Pagina99 (Italie, 16 juin 2017)
Nel quotidiano Pagina99, numero speciale del weekend 17 giugno 2017 “algoritmi e sorveglianza”, una lunga intervista rilasciata al giornalista Samuele… read more Pagina99 (Italie, 16 juin 2017)
[Vidéo] Grand entretien Mediapart : l’impact des fermes à clic sur les élections (17 déc. 2016)
J’ai rendu visite à la rédaction de Mediapart pour une interview vidéo sur “fake news”, algorithmes et tâcherons du clic…. read more [Vidéo] Grand entretien Mediapart : l’impact des fermes à clic sur les élections (17 déc. 2016)

Bulles de filtres, spirales de silence, algorithmes et politique (NextINpact, 23 nov. 2016)
(Article paru sur NextINpact, 23 novembre 2016) Élection de Trump : influence ou innocence, le rôle de Facebook en questions… read more Bulles de filtres, spirales de silence, algorithmes et politique (NextINpact, 23 nov. 2016)

Qui a fait élire Trump ? Pas les algorithmes, mais des millions de “tâcherons du clic” sous-payés
Ce billet a été publié par L’Obs / Rue89 le 19 novembre 2016. Une version en anglais est disponible ici…. read more Qui a fait élire Trump ? Pas les algorithmes, mais des millions de “tâcherons du clic” sous-payés
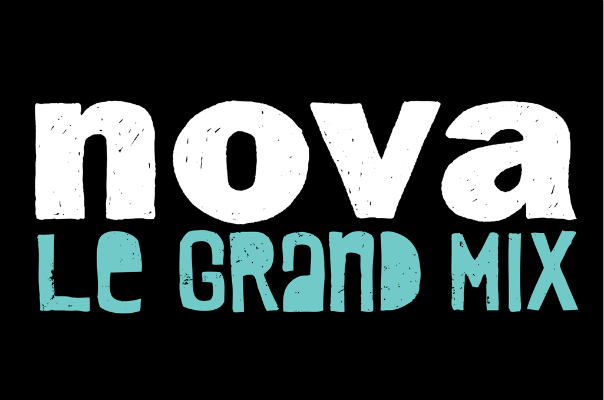
Entretien : algorithmes et vie privée (Radio Nova, 16 nov. 2016)
Ce matin à 7h15 j’ai pris le premier café de la journée en compagnie d’Edouard Baer et de sa joyeuse… read more Entretien : algorithmes et vie privée (Radio Nova, 16 nov. 2016)
![[Vidéo] [séminaire #ECNEHESS] Angèle Christin (ft. Berlin Tech Workers Coalition) : “De l’éthique à l’ethnographie des algorithmes” (wébinaire, 11 mars 2021, 19h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/algoritheAC.jpg)
![[Vidéo] Grand entretien Mediapart : l’impact des fermes à clic sur les élections (17 déc. 2016)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/12/debat-37-illustr01-bis.jpeg)