Tag: colonialité

Dans l’Humanité, mon interview sur colonialité et travail du clic (9 déc. 2022)
Dans le cadre d’un grand dossier que le quotidien L’Humanité consacre aux travaux de notre équipe de recherche DiPLab, un… read more Dans l’Humanité, mon interview sur colonialité et travail du clic (9 déc. 2022)

Pour un tournant décolonial numérique (Télérama, 5 févr. 2018)
Dans Télérama, l’entretien accordé au journaliste Romain Jeanticou. La domination des géants du numérique est-elle un nouveau colonialisme ? Romain… read more Pour un tournant décolonial numérique (Télérama, 5 févr. 2018)
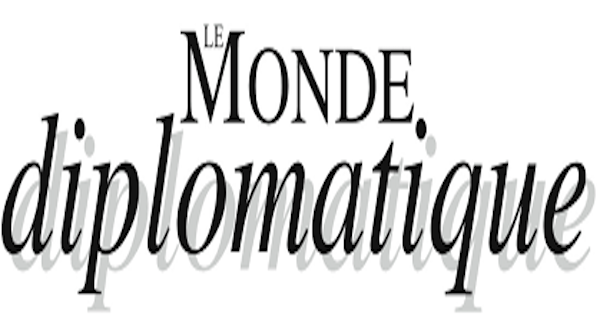
Dans le Monde Diplomatique (déc. 2017)
Dans Le Monde Diplomatique (plus précisément dans son bimestriel « Manière de voir »), Thibault Henneton se penche sur la… read more Dans le Monde Diplomatique (déc. 2017)

Colonialisme numérique ? (dans Usbek&Rica, oct-nov. 2017)
Dans le numéro 20 (oct-nov. 2017) du magazine de technologie, prospective et société Usbek & Rica, un long essai de… read more Colonialisme numérique ? (dans Usbek&Rica, oct-nov. 2017)