Tag: données personnelles

Dans 60 millions de consommateurs (nov. 2019)
Dans le numéro 553 (novembre 2019) du mensuel 60 millions de consommateurs, j’ai accordé un entretien dans le cadre de… read more Dans 60 millions de consommateurs (nov. 2019)

Le RGPD, un premier pas dans la bonne direction (grand entretien Libération, 25 mai 2018)
Antonio Casilli : «Avec le RGPD, il devient possible de défendre collectivement nos données» Par Christophe Alix — 24 mai… read more Le RGPD, un premier pas dans la bonne direction (grand entretien Libération, 25 mai 2018)
![[Vidéo] Les travailleurs de la donnée sur France Culture (14 févr. 2018)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2018/02/casillifrcyt22.png)
[Vidéo] Les travailleurs de la donnée sur France Culture (14 févr. 2018)
J’étais l’invité d’Olivia Gesbert à La Grande Table de France Culture pour parler de données personnelles, travail numérique, et fausses… read more [Vidéo] Les travailleurs de la donnée sur France Culture (14 févr. 2018)
![[Podcast] Vie privée et revente des données personnelles (France Culture, 14 févr. 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)
[Podcast] Vie privée et revente des données personnelles (France Culture, 14 févr. 2017)
Podcast de mon intervention à La Grande Table de France Culture. Vie privée, plateformes numériques et les idiots utiles qui… read more [Podcast] Vie privée et revente des données personnelles (France Culture, 14 févr. 2017)

Pourquoi la vente de nos données personnelles (contre un plat de lentilles) est une très mauvaise idée
Jacob dit : ‘Vends-moi aujourd’hui tes données”. “Voici”, s’exclama Esaü, “je m’en vais mourir de faim ! A quoi me… read more Pourquoi la vente de nos données personnelles (contre un plat de lentilles) est une très mauvaise idée

Dans la revue ADN (3 avril 2017)
Dans le numéro 10 de la revue ADN, une longue interview sur données personnelles, pouvoir des GAFAM et surveillance de… read more Dans la revue ADN (3 avril 2017)
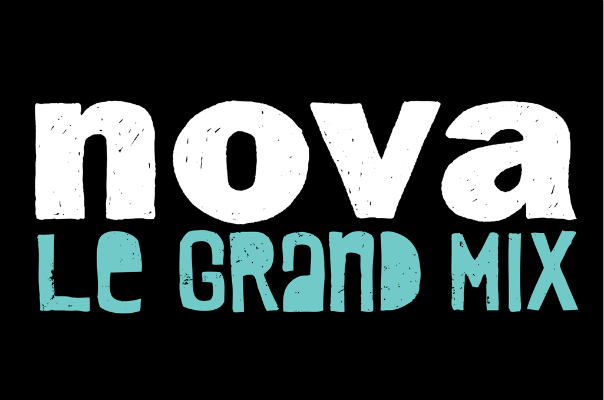
Entretien : algorithmes et vie privée (Radio Nova, 16 nov. 2016)
Ce matin à 7h15 j’ai pris le premier café de la journée en compagnie d’Edouard Baer et de sa joyeuse… read more Entretien : algorithmes et vie privée (Radio Nova, 16 nov. 2016)
[Slides séminaire #ecnEHESS] Christophe Benavent : Plateformes et gouvernementalité algorithmique (21 nov. 2016, 17h)
Pour la première séance de mon séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques nous avons… read more [Slides séminaire #ecnEHESS] Christophe Benavent : Plateformes et gouvernementalité algorithmique (21 nov. 2016, 17h)

Dans Le Monde Diplomatique (sept. 2016)
Un article signé Pierre Rimbert à propos de digital labor et revenu de base, paru dans la livraison du mois… read more Dans Le Monde Diplomatique (sept. 2016)
![[Vidéo] Interview “Ouvrez le 1” (France Info Tv, 21 févr. 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/Ouvrez-FrInfoTv.png)
![[Slides séminaire #ecnEHESS] Christophe Benavent : Plateformes et gouvernementalité algorithmique (21 nov. 2016, 17h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/gears-and-86739623.jpg)