Tag: surveillance de masse

Posted in Media features
Tribune : « StopCovid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers » (Le Monde, 25 avr. 2020)
Avec le mathématicien Paul-Olivier Dehaye et l’avocat Jean-Baptiste Soufron, je cosigne cette tribune dans Le Monde contre le projet d’application… read more Tribune : « StopCovid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers » (Le Monde, 25 avr. 2020)
admin 25 April 2020

Posted in Blog
L’enfer de la reconnaissance faciale est pavé de débats sur son “acceptabilité sociale”
Dans la rubrique “Fausses bonnes idées”, Libération publie une tribune signée par des député•es LREM, des représentants de think tank,… read more L’enfer de la reconnaissance faciale est pavé de débats sur son “acceptabilité sociale”
admin 18 December 2019
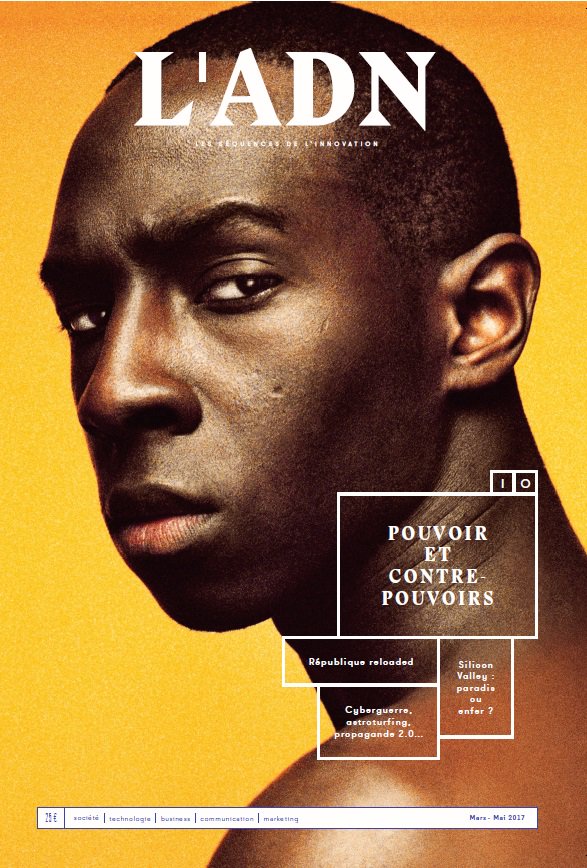
Posted in Media features
Dans la revue ADN (3 avril 2017)
Dans le numéro 10 de la revue ADN, une longue interview sur données personnelles, pouvoir des GAFAM et surveillance de… read more Dans la revue ADN (3 avril 2017)
admin 13 April 2017
![[Vidéo] Grand entretien : Covid-19 et surveillance de masse (France Télévisions Slash, 21 avr. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/FTvSlash.png)