Tag: travail du clic

Dans l’Humanité, mon interview sur colonialité et travail du clic (9 déc. 2022)
Dans le cadre d’un grand dossier que le quotidien L’Humanité consacre aux travaux de notre équipe de recherche DiPLab, un… read more Dans l’Humanité, mon interview sur colonialité et travail du clic (9 déc. 2022)
[Podcast] Interview dans l’émission “Un monde nouveau” (Radio France Inter, 25 juill. 2022)
Quels hommes se cachent derrière les robots ? Réponses avec le sociologue Antonio Casilli, professeur à l’Institut Polytechnique de Paris et… read more [Podcast] Interview dans l’émission “Un monde nouveau” (Radio France Inter, 25 juill. 2022)
[Podcast] Travailleurs et consommateurs des plateformes : ensemble pour une nouvelle conscience de classe (Le Temps du Débat, France Culture, 1 mai 2021)
À l’occasion de la Fête du Travail 2021, j’ai été l’invité de François Saltiel pour l’émission Le Temps du Débat,… read more [Podcast] Travailleurs et consommateurs des plateformes : ensemble pour une nouvelle conscience de classe (Le Temps du Débat, France Culture, 1 mai 2021)
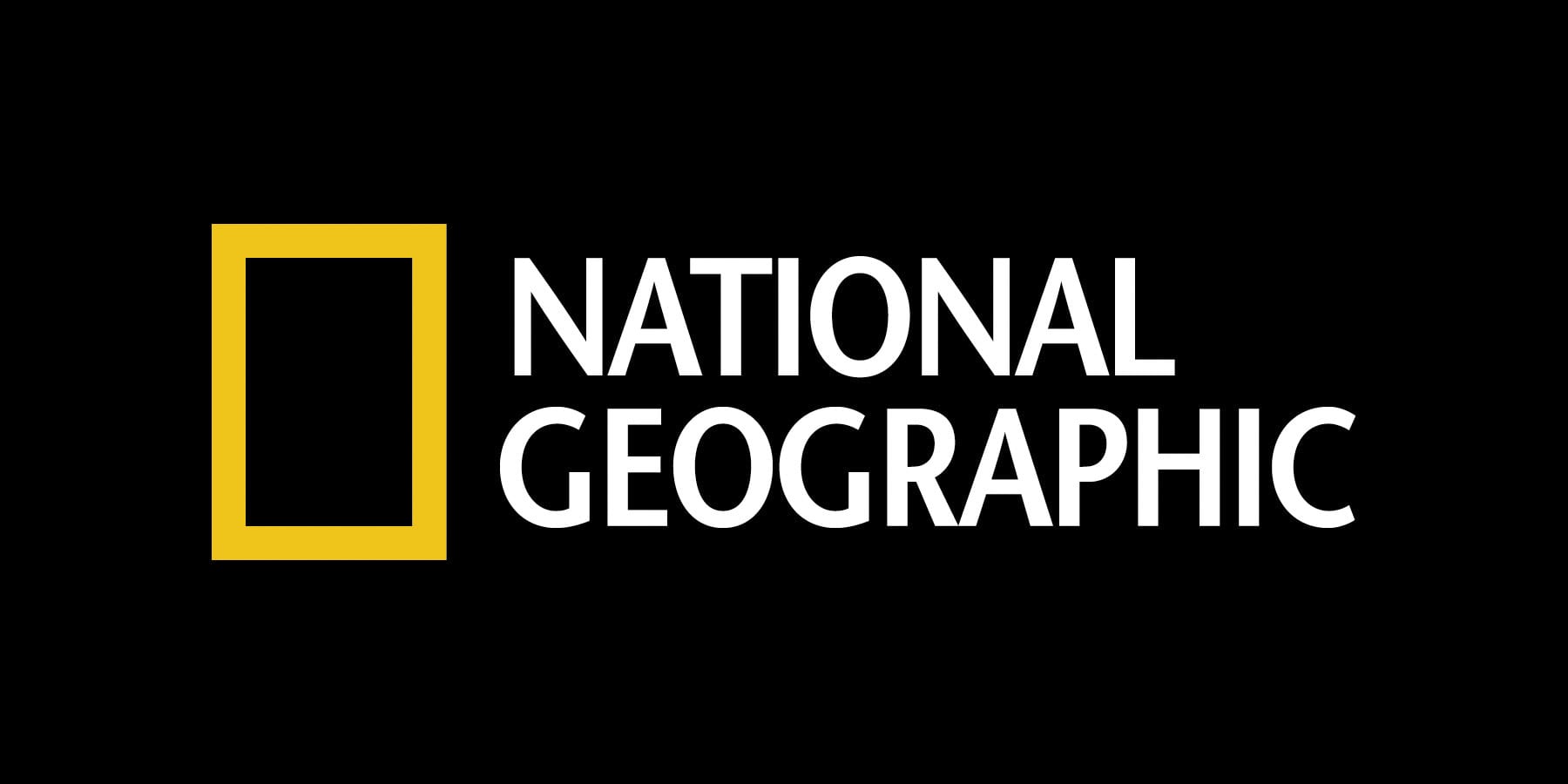
Grand entretien dans le National Geographic (15 oct. 2020)
En entretien avec la journaliste Marie-Amélie Carpio, National Geographic France. Les ouvriers du clic, le prolétariat 2.0 Contrairement à ce… read more Grand entretien dans le National Geographic (15 oct. 2020)
[Podcast] Grand entretien “Comment le confinement a montré les limites du tout-numérique” (RFI, 13 juin 2020)
Dans cet entretien avec Antonio Casilli, il est question des chaînes logistiques durant le confinement (des entrepôts aux « travailleurs du dernier kilomètre »),… read more [Podcast] Grand entretien “Comment le confinement a montré les limites du tout-numérique” (RFI, 13 juin 2020)
[Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)
Une séance animée par Florent Le Bot, IDHES, université d’Evry, organisée avec Nathalie Barnault (Bibliothèque Durkeim, ENS Paris-Saclay) et réalisée… read more [Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)
![[Update avril 2022] [Vidéo] Notre documentaire “Invisibles – Les travailleurs du clic” (France Télévisions, 12 févr. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/02/ob_2062cb_header-cp.png)
[Update avril 2022] [Vidéo] Notre documentaire “Invisibles – Les travailleurs du clic” (France Télévisions, 12 févr. 2020)
[UPDATE AVRIL 2022] Une nouvelle version d’un seul épisode de 90′ de notre série documentaire “Invisibles. Les travailleurs du clic”… read more [Update avril 2022] [Vidéo] Notre documentaire “Invisibles – Les travailleurs du clic” (France Télévisions, 12 févr. 2020)

Recension vidéo dans Xerfi Canal (16 juillet 2019)
Une enquête sur les travailleurs de force du CLIC Ghislain Deslandes – Professeur à l’ESCP Europe et directeur de programme… read more Recension vidéo dans Xerfi Canal (16 juillet 2019)
![[Podcast] Interview dans l’émission “Un monde nouveau” (Radio France Inter, 25 juill. 2022)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2013/09/LogoFranceInter.jpg)
![[Podcast] Travailleurs et consommateurs des plateformes : ensemble pour une nouvelle conscience de classe (Le Temps du Débat, France Culture, 1 mai 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)
![[Video] Interview sur “En attendant les robots” (Institut Français, 1 avr. 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/05/logo_institutfrancais_1.jpg)
![[Podcast] Interview dans Point de Suspension(s) (Unédic, 22 déc. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/unedic-Casilli.jpeg)
![[Podcast] Grand entretien “Comment le confinement a montré les limites du tout-numérique” (RFI, 13 juin 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2010/10/LogoAMRFI.jpg)
![[Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/bandeau-web-pdd-casilli-1280x640-1.jpg)