Tag: trump
[Video] Exposing Trump, Musk, and the Other Techno-Fascists: My Interview with Blast
For years, we’ve been bombarded with the idea that artificial intelligence is the answer to all our problems. A revolution,… read more [Video] Exposing Trump, Musk, and the Other Techno-Fascists: My Interview with Blast
admin 19 March 2025
[Vidéo] Interview sur censure et médias sociaux (RTS, 27 janv. 2021)
Réseaux sociaux: la censure ou la bavure? J’étais l’invité de l’émission Forum sur la Radio Télévision Suisse.
admin 27 January 2021
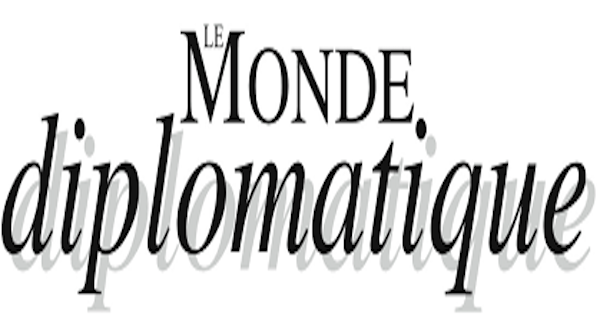
Posted in Media features
Dans le Monde Diplomatique (déc. 2017)
Dans Le Monde Diplomatique (plus précisément dans son bimestriel « Manière de voir »), Thibault Henneton se penche sur la… read more Dans le Monde Diplomatique (déc. 2017)
admin 9 December 2017

Posted in Blog
A Semantic Desublimation of Donald Trump’s Handshake
(To be read at full speed, with frequent sniffings and a thick Žižek accent). There’s something quasi-paranoid about the… read more A Semantic Desublimation of Donald Trump’s Handshake
admin 25 May 2017
![[Video] Exposing Trump, Musk, and the Other Techno-Fascists: My Interview with Blast](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2025/03/blast1-480x274.png)
![[Vidéo] Interview sur censure et médias sociaux (RTS, 27 janv. 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/RTSlogo.png)