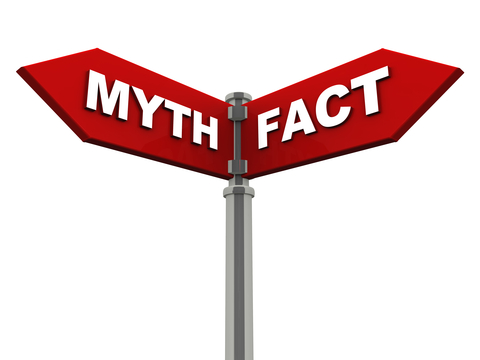Month: March 2014
Les usines digitales du Web : L'Humanité interviewe Antonio Casilli (31 mars 2014)
Dans le quotidien L’Humanité, un dossier de Pierric Marissal (version pepier) et une longue interview (version en ligne) avec le sociologue… read more Les usines digitales du Web : L'Humanité interviewe Antonio Casilli (31 mars 2014)

Four “moral entrepreneurs” who want you to believe that your privacy is over
A moral entrepreneur is an individual, group or formal organization that seeks to influence a group to adopt or maintain… read more Four “moral entrepreneurs” who want you to believe that your privacy is over
Ailleurs dans les médias (févr. – mars 2014)
Ailleurs dans les médias : journaux, blogs, émissions qui discutent, résument, citent les recherches et les textes du sociologue et… read more Ailleurs dans les médias (févr. – mars 2014)
[Slides] Séminaire EHESS AA Casilli & P Tubaro – 'Web et privacy : le renoncement à la vie privée n'a jamais eu lieu'
Dans le cadre de mon séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques, j’ai eu le… read more [Slides] Séminaire EHESS AA Casilli & P Tubaro – 'Web et privacy : le renoncement à la vie privée n'a jamais eu lieu'
[Vidéo] “La vie privée n’est pas morte !” – Antonio Casilli dans Arrêt sur images (05 mars 2014)
Sur le site Web d’information @rret sur images, l’émission 14H42, présentée par Jean-Marc Manach et préparée en collaboration avec PCINpact.com,… read more [Vidéo] “La vie privée n’est pas morte !” – Antonio Casilli dans Arrêt sur images (05 mars 2014)
[Podcast] Antonio Casilli invité de Place de la Toile pour le spécial Week End Numérique de France Culture (1 mars 2014)
Dans l’émission Place de la Toile (France Culture, 1 mars 2014), Xavier de la Porte et Thibault Henneton ont acueilli… read more [Podcast] Antonio Casilli invité de Place de la Toile pour le spécial Week End Numérique de France Culture (1 mars 2014)
30 références pour démystifier 10 idées reçues sur le numérique #pdlt
Hello folks, si vous êtes des habitués de ce blog ou si vous arrivez ici après avoir écouté l’émission Place… read more 30 références pour démystifier 10 idées reçues sur le numérique #pdlt
![[Slides] Séminaire EHESS AA Casilli & P Tubaro – 'Web et privacy : le renoncement à la vie privée n'a jamais eu lieu'](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2014/03/privacyNegotiation.jpg)
![[Vidéo] “La vie privée n’est pas morte !” – Antonio Casilli dans Arrêt sur images (05 mars 2014)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2014/03/arretsurimages.68970.jpg)