Month: July 2019

Recension dans La Vie des Idées (24 juillet 2019)
Cannibale machine À propos de : Antonio Casilli, En attendant les robots, Seuil Des machines intelligentes à l’assaut du travail humain ?… read more Recension dans La Vie des Idées (24 juillet 2019)

Grand entretien dans L’Echo (Belgique, 22 juillet 2019)
Antonio Casilli: “Derrière l’intelligence artificielle, il y a des humains peu rémunérés” Non, les robots ne vont pas remplacer le… read more Grand entretien dans L’Echo (Belgique, 22 juillet 2019)

Recension vidéo dans Xerfi Canal (16 juillet 2019)
Une enquête sur les travailleurs de force du CLIC Ghislain Deslandes – Professeur à l’ESCP Europe et directeur de programme… read more Recension vidéo dans Xerfi Canal (16 juillet 2019)

Ailleurs dans les médias (avr. – sept. 2019)
(17 sept. 2019) Vers un coopératisme de plate-forme ?, Futuribles. (29 août 2019) « Les robots ne vont pas remplacer… read more Ailleurs dans les médias (avr. – sept. 2019)
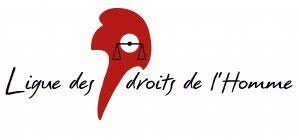
Recension dans “Hommes & Liberté” (revue de la Ligue des Droits de l’Homme, n. 187, juill. 2019)
Alors que se multiplient les dis-cours sur le remplacement de tout ou partie du travail humain par l’intelligence artificielle (IA),… read more Recension dans “Hommes & Liberté” (revue de la Ligue des Droits de l’Homme, n. 187, juill. 2019)
![[Video] Einstein Forum Conference on fake news and digital labor (Germany, 5 July 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/08/Einstein-Forum-logo.jpg)
[Video] Einstein Forum Conference on fake news and digital labor (Germany, 5 July 2019)
Video of my Einstein Forum Lecture, Potsdam, 5 July 2019. Automating Credulity. The Digital Labor Behind Fake News and Propaganda… read more [Video] Einstein Forum Conference on fake news and digital labor (Germany, 5 July 2019)
![[Vidéo] Le micro-travail en France (séminaire CFE-CGC Orange, Paris, 1 juillet 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/08/CFE-CGC-Screenshot.png)
[Vidéo] Le micro-travail en France (séminaire CFE-CGC Orange, Paris, 1 juillet 2019)
Avec Paola Tubaro (CNRS), j’ai présenté lors du séminaire de la CFE-CGC Orange nos travaux concernant les « petites mains… read more [Vidéo] Le micro-travail en France (séminaire CFE-CGC Orange, Paris, 1 juillet 2019)