Month: November 2019

Dans Philonomist (nov. 2019)
Dans le magazine en ligne Philonomist, branche web de Philosophie magazine, un entretien croisé entre moi et Dominique Méda sur… read more Dans Philonomist (nov. 2019)
[Video] Entrevista al programa “30 minuts” (TV3 Catalunya, 22 nov. 2019)
M’han entrevistat pel programa “30 minuts” (televisió Catalana TV3), sobre el treball de plataformes, el micro-treball i l’economia freelance. El… read more [Video] Entrevista al programa “30 minuts” (TV3 Catalunya, 22 nov. 2019)
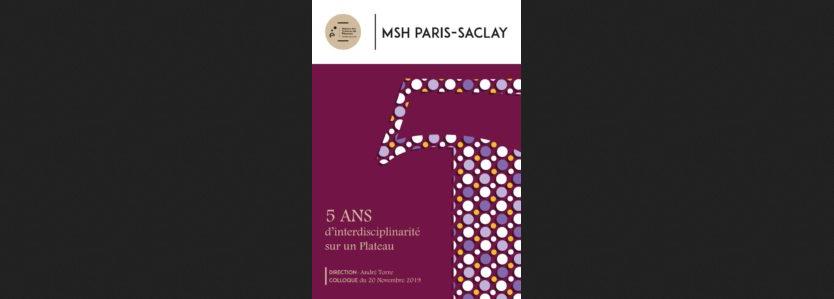
Interview dans le livre-anniversaire de la MSH Paris-Saclay (20 nov. 2019)
A l’occasion de ses 5 ans, la MSH Paris-Saclay a sorti un livre bilan de ses 5 ans d’activités, assorti 10… read more Interview dans le livre-anniversaire de la MSH Paris-Saclay (20 nov. 2019)
[Podcast] Emission “La Méthode Scientifique” (France Culture, 11 nov. 2019)
En compagnie de Benjamin Bayard, j’ai eu le plaisir d’être l’invité de Nicolas Martin sur le plateau de France Culture… read more [Podcast] Emission “La Méthode Scientifique” (France Culture, 11 nov. 2019)
![[Séminaire #ecnEHESS] Comment étudier les communautés d’internet ? (Madeleine Pastinelli, 14 nov. 2019, 16h)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/11/ethnoPastinelli.png)
[Séminaire #ecnEHESS] Comment étudier les communautés d’internet ? (Madeleine Pastinelli, 14 nov. 2019, 16h)
Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Pour la première séance d’approfondissement ouverte aux auditeurs… read more [Séminaire #ecnEHESS] Comment étudier les communautés d’internet ? (Madeleine Pastinelli, 14 nov. 2019, 16h)

Dans 60 millions de consommateurs (nov. 2019)
Dans le numéro 553 (novembre 2019) du mensuel 60 millions de consommateurs, j’ai accordé un entretien dans le cadre de… read more Dans 60 millions de consommateurs (nov. 2019)
![[Video] Entrevista al programa “30 minuts” (TV3 Catalunya, 22 nov. 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/12/30-minuts.png)
![[Podcast] Emission “La Méthode Scientifique” (France Culture, 11 nov. 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)