Tag: en attendant les robots
[Podcast] Conférence “Venir à l’Histoire” (26 sept. 2020, Librairie Ombres Blanches, Toulouse)
Les robots vont-ils remplacer les humains au travail ? Les « intelligences artificielles » sont-elles réellement intelligentes ? Ces questions ne sont pas les… read more [Podcast] Conférence “Venir à l’Histoire” (26 sept. 2020, Librairie Ombres Blanches, Toulouse)
[Update Gennaio 2021] Arriva in libreria ‘Schiavi del clic’ (Feltrinelli), traduzione italiana del mio ‘En attendant les robots’!
UPDATE GENNAIO 2021 : Schiavi del clic è stato selezionato nella cinquina dei finalisti del Premio Galileo per la divulgazione… read more [Update Gennaio 2021] Arriva in libreria ‘Schiavi del clic’ (Feltrinelli), traduzione italiana del mio ‘En attendant les robots’!
![Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/Logo_de_Relations.png)
Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]
Par : Emiliano Arpin-Simonetti Dans son dernier ouvrage En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic (Seuil, 2019), Antonio A…. read more Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]
[Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)
Une séance animée par Florent Le Bot, IDHES, université d’Evry, organisée avec Nathalie Barnault (Bibliothèque Durkeim, ENS Paris-Saclay) et réalisée… read more [Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)
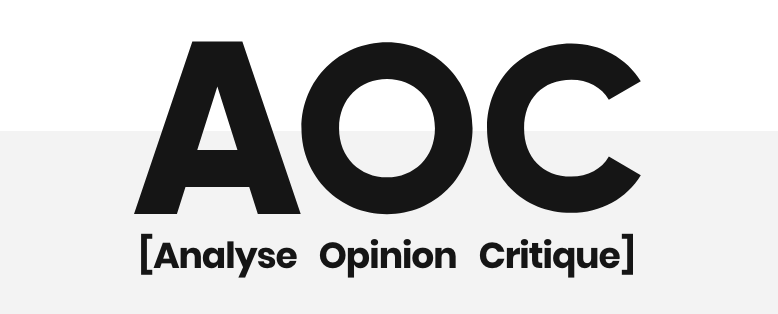
“Pour sortir de cette crise pandémique il faut abattre la surveillance de masse” (grand entretien, AOC, 28 mars 2020)
Le 20 mars, quelques jours après le début du confinement en France, je me suis entretenu pendant un bon moment… read more “Pour sortir de cette crise pandémique il faut abattre la surveillance de masse” (grand entretien, AOC, 28 mars 2020)

Mon ouvrage «En attendant les robots», Prix de l’Écrit Social 2019
Le 6 février 2020, à Nantes, j’ai eu le plaisir de recevoir le Prix de l’Écrit Social (catégorie ouvrage) pour… read more Mon ouvrage «En attendant les robots», Prix de l’Écrit Social 2019

‘Wachten op de robots’ (Stichting Beroepseer, Nederland, 3 feb. 2020)
‘Wachten op de robots’. Onderzoek naar de ‘onzichtbare’ microwerkers op digitale platforms – Stichting Beroepseer ‘Microwerk is onzichtbaar voor het… read more ‘Wachten op de robots’ (Stichting Beroepseer, Nederland, 3 feb. 2020)
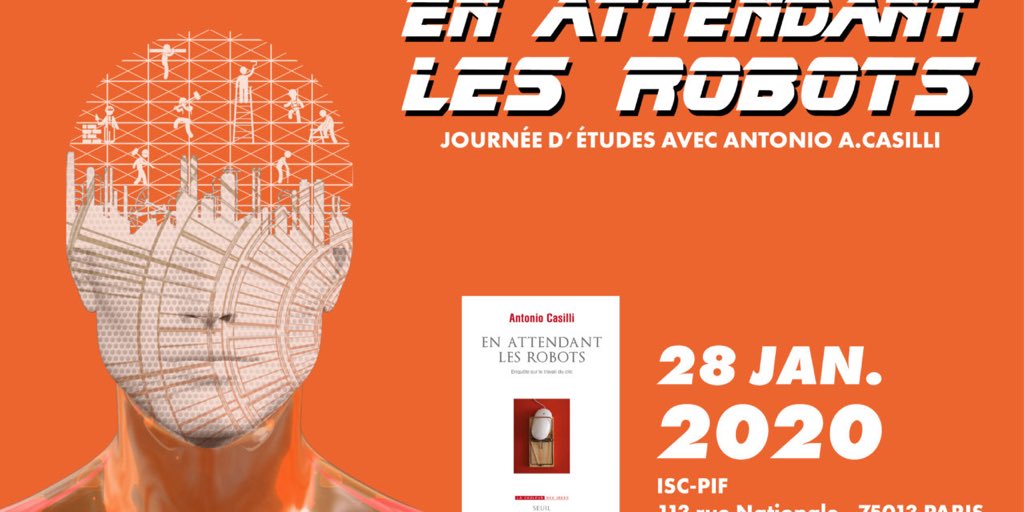
Journée d’études “En attendant les robots” (28 janv. 2020)
La MSH Paris Saclay, en collaboration avec la revue L’Homme et la Société et les Editions du Seuil, m’a fait… read more Journée d’études “En attendant les robots” (28 janv. 2020)
![[Vidéo] En dialogue avec Clément Viktorovitch (CliqueTV, 19 janv. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/01/CliqueTV_VVLD.png)
[Vidéo] En dialogue avec Clément Viktorovitch (CliqueTV, 19 janv. 2020)
Vidéo de mon interview dans l’émission Viens Voir Les Docteurs, avec Clément Viktorovitch. L’intelligence artificielle est l’objet de tous les… read more [Vidéo] En dialogue avec Clément Viktorovitch (CliqueTV, 19 janv. 2020)
![[Vidéo] Avec Alain Supiot à Nantes (14 janv. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/01/LieuUniqueSupiot.png)
[Vidéo] Avec Alain Supiot à Nantes (14 janv. 2020)
A l’initiative de Pierre Musso et dans le cadre des Mardis de l’IEAoLU, un cycle de conférences organisé par l’IEA… read more [Vidéo] Avec Alain Supiot à Nantes (14 janv. 2020)
![[Podcast] Conférence “Venir à l’Histoire” (26 sept. 2020, Librairie Ombres Blanches, Toulouse)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2011/03/ombresLogo.jpg)
![[Update Gennaio 2021] Arriva in libreria ‘Schiavi del clic’ (Feltrinelli), traduzione italiana del mio ‘En attendant les robots’!](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/Schiavi-Quarta-di-Copertina-.png)
![[Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/bandeau-web-pdd-casilli-1280x640-1.jpg)