Tag: intelligence artificielle
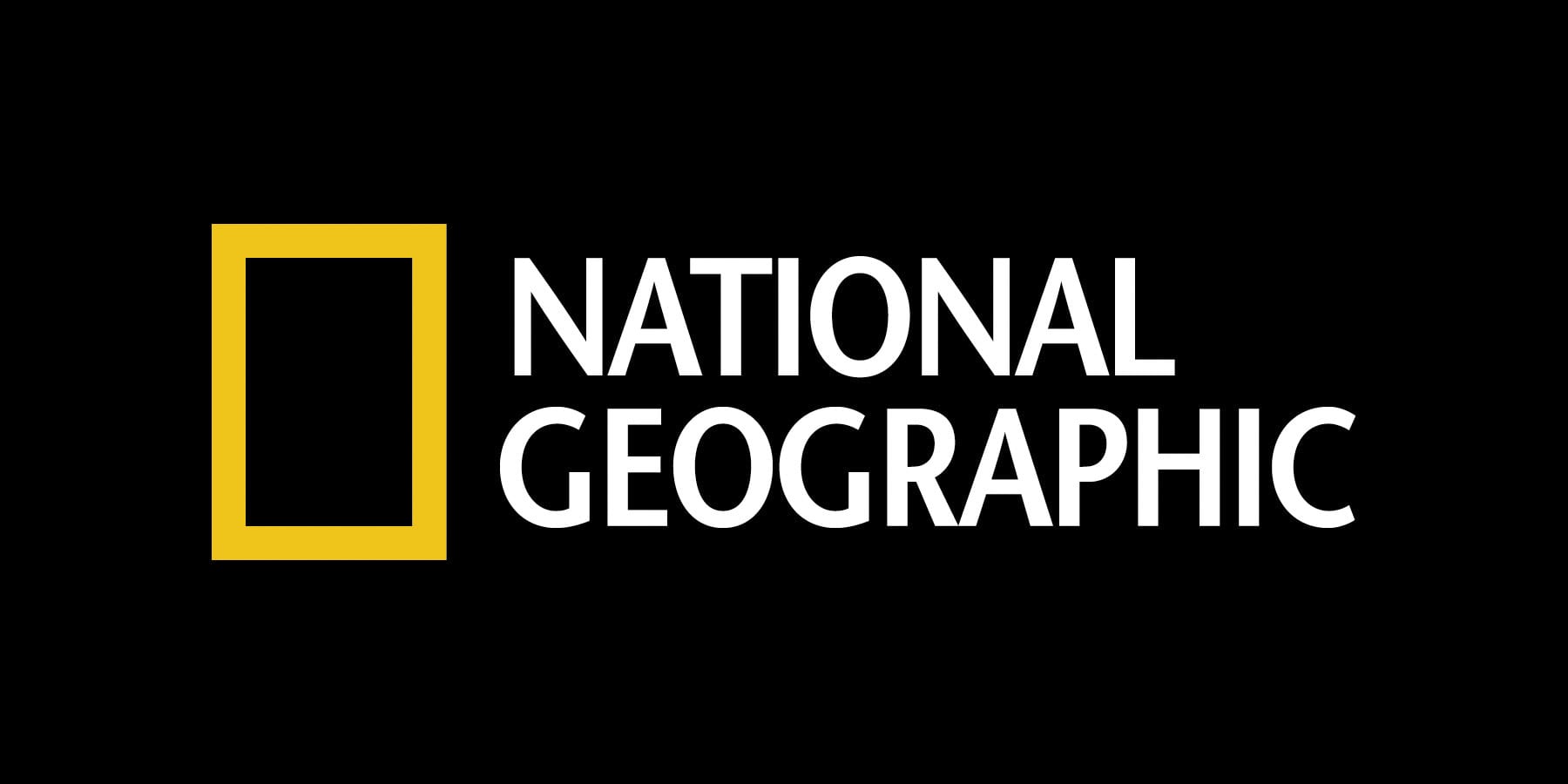
Grand entretien dans le National Geographic (15 oct. 2020)
En entretien avec la journaliste Marie-Amélie Carpio, National Geographic France. Les ouvriers du clic, le prolétariat 2.0 Contrairement à ce… read more Grand entretien dans le National Geographic (15 oct. 2020)
[Podcast] IA et Coronavirus (France Inter, 18 août 2020)
Intelligences artificielles à l’heure du coronavirus De visioconférence en téléconsultation médicale, la crise sanitaire a changé notre rapport aux algorithmes…. read more [Podcast] IA et Coronavirus (France Inter, 18 août 2020)
![Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/Logo_de_Relations.png)
Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]
Par : Emiliano Arpin-Simonetti Dans son dernier ouvrage En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic (Seuil, 2019), Antonio A…. read more Grand entretien dans la revue Relations [no. 808 – mai-juin 2020]
[Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)
Une séance animée par Florent Le Bot, IDHES, université d’Evry, organisée avec Nathalie Barnault (Bibliothèque Durkeim, ENS Paris-Saclay) et réalisée… read more [Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)
![[Update avril 2022] [Vidéo] Notre documentaire “Invisibles – Les travailleurs du clic” (France Télévisions, 12 févr. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/02/ob_2062cb_header-cp.png)
[Update avril 2022] [Vidéo] Notre documentaire “Invisibles – Les travailleurs du clic” (France Télévisions, 12 févr. 2020)
[UPDATE AVRIL 2022] Une nouvelle version d’un seul épisode de 90′ de notre série documentaire “Invisibles. Les travailleurs du clic”… read more [Update avril 2022] [Vidéo] Notre documentaire “Invisibles – Les travailleurs du clic” (France Télévisions, 12 févr. 2020)

Mon ouvrage «En attendant les robots», Prix de l’Écrit Social 2019
Le 6 février 2020, à Nantes, j’ai eu le plaisir de recevoir le Prix de l’Écrit Social (catégorie ouvrage) pour… read more Mon ouvrage «En attendant les robots», Prix de l’Écrit Social 2019

Tribune dans Le Monde (6 févr. 2020)
« L’avènement du dresseur d’intelligences artificielles » Tribune. Face aux inquiétudes autour de l’effacement annoncé du travail humain par une… read more Tribune dans Le Monde (6 févr. 2020)
![[Vidéo] En dialogue avec Clément Viktorovitch (CliqueTV, 19 janv. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/01/CliqueTV_VVLD.png)
[Vidéo] En dialogue avec Clément Viktorovitch (CliqueTV, 19 janv. 2020)
Vidéo de mon interview dans l’émission Viens Voir Les Docteurs, avec Clément Viktorovitch. L’intelligence artificielle est l’objet de tous les… read more [Vidéo] En dialogue avec Clément Viktorovitch (CliqueTV, 19 janv. 2020)
![[Vidéo] Avec Alain Supiot à Nantes (14 janv. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/01/LieuUniqueSupiot.png)
[Vidéo] Avec Alain Supiot à Nantes (14 janv. 2020)
A l’initiative de Pierre Musso et dans le cadre des Mardis de l’IEAoLU, un cycle de conférences organisé par l’IEA… read more [Vidéo] Avec Alain Supiot à Nantes (14 janv. 2020)
[Podcast] Emission “La Méthode Scientifique” (France Culture, 11 nov. 2019)
En compagnie de Benjamin Bayard, j’ai eu le plaisir d’être l’invité de Nicolas Martin sur le plateau de France Culture… read more [Podcast] Emission “La Méthode Scientifique” (France Culture, 11 nov. 2019)
![[Podcast] IA et Coronavirus (France Inter, 18 août 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2013/09/LogoFranceInter.jpg)
![[Vidéo] Séminaire Web “Petits déjeuners Durkheim” (29 mai 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/bandeau-web-pdd-casilli-1280x640-1.jpg)
![[Podcast] Emission “La Méthode Scientifique” (France Culture, 11 nov. 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)