Tag: plateformes numériques

Interview dans Ouest-France (16 juin 22)
Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, de nombreux Français sont contraints de recourir à un petit boulot. Mais… read more Interview dans Ouest-France (16 juin 22)
[Podcast] Comment les nouvelles plateformes de commerce rapide changent la consommation et la ville (Le temps du débat, France Culture, 9 févr. 2022)
J’ai eu le plaisir de passer à l’antenne avec Philippe Moati et Laetitia Dablanc lors de l’émission de France Culture… read more [Podcast] Comment les nouvelles plateformes de commerce rapide changent la consommation et la ville (Le temps du débat, France Culture, 9 févr. 2022)
[Podcast] Travailleurs et consommateurs des plateformes : ensemble pour une nouvelle conscience de classe (Le Temps du Débat, France Culture, 1 mai 2021)
À l’occasion de la Fête du Travail 2021, j’ai été l’invité de François Saltiel pour l’émission Le Temps du Débat,… read more [Podcast] Travailleurs et consommateurs des plateformes : ensemble pour une nouvelle conscience de classe (Le Temps du Débat, France Culture, 1 mai 2021)
[Podcast] Grand entretien dans “Le code a changé” avec Xavier de La Porte (28 sept. 2020)
COVID, confinement et grande conversion numérique, avec Antonio Casilli Xavier de La Porte Depuis le début de cette épidémie de… read more [Podcast] Grand entretien dans “Le code a changé” avec Xavier de La Porte (28 sept. 2020)
[Podcast] “Prolétaires du web” une série de reportages radio pour la RTS (6 sept. 2020)
Pendant une semaine, sur la Radio Télévision Suisse Gérald Wang consacre 5 reportages aux nouveaux métiers précaires du web :… read more [Podcast] “Prolétaires du web” une série de reportages radio pour la RTS (6 sept. 2020)
[Podcast] Grand entretien “Comment le confinement a montré les limites du tout-numérique” (RFI, 13 juin 2020)
Dans cet entretien avec Antonio Casilli, il est question des chaînes logistiques durant le confinement (des entrepôts aux « travailleurs du dernier kilomètre »),… read more [Podcast] Grand entretien “Comment le confinement a montré les limites du tout-numérique” (RFI, 13 juin 2020)
![[Vidéo] Grand entretien «À l’air libre»: confinement et colère sociale (Mediapart, 15 avril 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/Mediapart-15042020-1.png)
[Vidéo] Grand entretien «À l’air libre»: confinement et colère sociale (Mediapart, 15 avril 2020)
Dans la deuxième partie de l’émission quotidienne de Mediapart “A l’air libre” (démarre à 54′), une conversation avec les journalistes… read more [Vidéo] Grand entretien «À l’air libre»: confinement et colère sociale (Mediapart, 15 avril 2020)
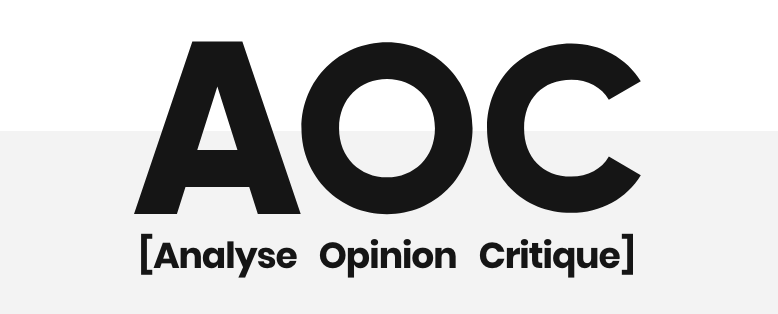
“Pour sortir de cette crise pandémique il faut abattre la surveillance de masse” (grand entretien, AOC, 28 mars 2020)
Le 20 mars, quelques jours après le début du confinement en France, je me suis entretenu pendant un bon moment… read more “Pour sortir de cette crise pandémique il faut abattre la surveillance de masse” (grand entretien, AOC, 28 mars 2020)
![[Podcast] Comment les nouvelles plateformes de commerce rapide changent la consommation et la ville (Le temps du débat, France Culture, 9 févr. 2022)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)
![[Podcast] Interview dans Point de Suspension(s) (Unédic, 22 déc. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/unedic-Casilli.jpeg)
![[Podcast] Grand entretien dans “Le code a changé” avec Xavier de La Porte (28 sept. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2013/09/LogoFranceInter.jpg)
![[Podcast] “Prolétaires du web” une série de reportages radio pour la RTS (6 sept. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/11/RTSlogo.png)
![[Podcast] Grand entretien “Comment le confinement a montré les limites du tout-numérique” (RFI, 13 juin 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2010/10/LogoAMRFI.jpg)