Tag: privacy
[Video] Massey Dialogues (University of Toronto, 29 Apr. 2020)
The Massey Dialogues – Prof. Antonio Casilli on COVID19 & Digital Labour: The Fate Of Last-Mile Workers Wednesday, April 29… read more [Video] Massey Dialogues (University of Toronto, 29 Apr. 2020)

“Coronavirus tracking apps are a serious threat to medical privacy” (BBC World Turkey, 2 April 2020)
I was interviewed by journalist Çağıl Kasapoğlu for BBC World Turkey. Casilli: Koronavirüs kitlesel gözetim ve veri toplama sistemlerini güçlendiriyor… read more “Coronavirus tracking apps are a serious threat to medical privacy” (BBC World Turkey, 2 April 2020)
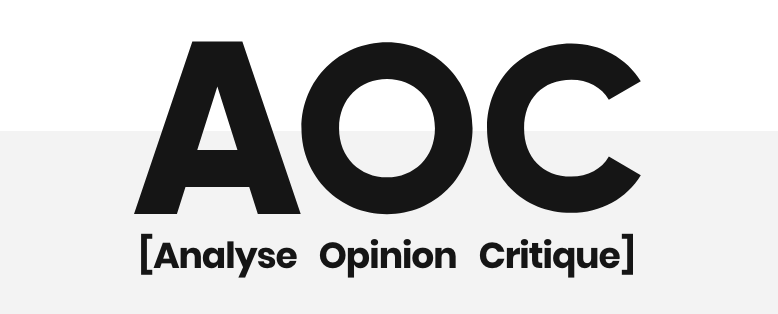
“Pour sortir de cette crise pandémique il faut abattre la surveillance de masse” (grand entretien, AOC, 28 mars 2020)
Le 20 mars, quelques jours après le début du confinement en France, je me suis entretenu pendant un bon moment… read more “Pour sortir de cette crise pandémique il faut abattre la surveillance de masse” (grand entretien, AOC, 28 mars 2020)

Dans 60 millions de consommateurs (nov. 2019)
Dans le numéro 553 (novembre 2019) du mensuel 60 millions de consommateurs, j’ai accordé un entretien dans le cadre de… read more Dans 60 millions de consommateurs (nov. 2019)

Interviewé dans l’enquête Mediapart sur assistants vocaux, digital labor et privacy (31 août 2019)
Le site d’information et d’enquête Mediapart publie les révélations depuis l’usine à “intelligence artificielle artificielle” de Siri, signées Jerome Hourdeaux…. read more Interviewé dans l’enquête Mediapart sur assistants vocaux, digital labor et privacy (31 août 2019)
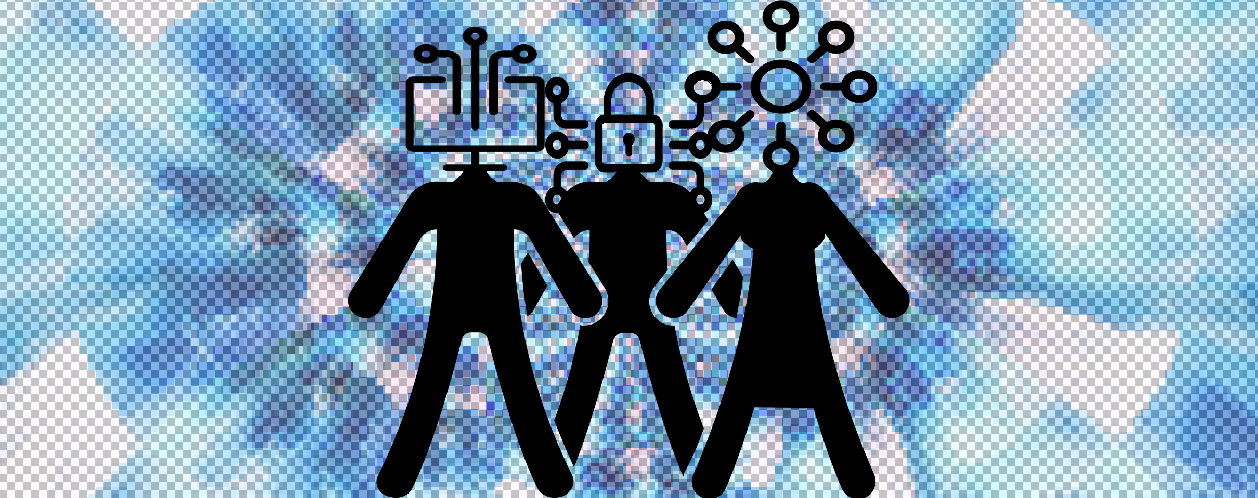
Le programme du séminaire #ecnEHESS 2018/19 est arrivé !
Mon séminaire Étudier les cultures du numérique (mieux connu comme #ecnEHESS) est de retour pour la 11e année consécutive. Structure… read more Le programme du séminaire #ecnEHESS 2018/19 est arrivé !

Le RGPD, un premier pas dans la bonne direction (grand entretien Libération, 25 mai 2018)
Antonio Casilli : «Avec le RGPD, il devient possible de défendre collectivement nos données» Par Christophe Alix — 24 mai… read more Le RGPD, un premier pas dans la bonne direction (grand entretien Libération, 25 mai 2018)

Why Facebook users’ “strikes” don’t work (and how can we fix them)?
Another day, another call for a Facebook “users’ strike”. This one would allegedly run from May 25 to June 1,… read more Why Facebook users’ “strikes” don’t work (and how can we fix them)?
![[Vidéo] Les travailleurs de la donnée sur France Culture (14 févr. 2018)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2018/02/casillifrcyt22.png)
[Vidéo] Les travailleurs de la donnée sur France Culture (14 févr. 2018)
J’étais l’invité d’Olivia Gesbert à La Grande Table de France Culture pour parler de données personnelles, travail numérique, et fausses… read more [Vidéo] Les travailleurs de la donnée sur France Culture (14 févr. 2018)
![[Vidéo] Interview “Ouvrez le 1” (France Info Tv, 21 févr. 2021)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2021/03/Ouvrez-FrInfoTv.png)
![[Video] Massey Dialogues (University of Toronto, 29 Apr. 2020)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2020/09/massey2.png)