Tag: sociology

Interview dans Ouest-France (16 juin 22)
Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, de nombreux Français sont contraints de recourir à un petit boulot. Mais… read more Interview dans Ouest-France (16 juin 22)

Le Digital Labor : exploités et heureux de l’être ? (Office et Culture, mai 2016)
Le Digital Labor : exploités et heureux de l’être ? par Chrystèle Bazin, 04/05/2016 Le succès fulgurant de certaines entreprises numériques… read more Le Digital Labor : exploités et heureux de l’être ? (Office et Culture, mai 2016)
![[Slides séminaire #ecnEHESS] Les univers de travail dans les jeux vidéo (B. Vétel & M. Cocq, 6 juin 2016)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/05/rullerova_t_govt4a_PLAYBOUR-playbour-power.jpg)
[Slides séminaire #ecnEHESS] Les univers de travail dans les jeux vidéo (B. Vétel & M. Cocq, 6 juin 2016)
Pour la dernière séance de l’année 2015/16 de mon séminaire EHESS Etudier le cultures du numérique, j’ai eu le plaisir… read more [Slides séminaire #ecnEHESS] Les univers de travail dans les jeux vidéo (B. Vétel & M. Cocq, 6 juin 2016)
![[Compte rendu séminaire #ecnEHESS] Trebor Scholz “Unpacking Platform Cooperativism” (7 déc. 2015)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/4585054120_8244ccc2dc.jpg)
[Compte rendu séminaire #ecnEHESS] Trebor Scholz “Unpacking Platform Cooperativism” (7 déc. 2015)
Dans le cadre de mon séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques, nous avons eu… read more [Compte rendu séminaire #ecnEHESS] Trebor Scholz “Unpacking Platform Cooperativism” (7 déc. 2015)

Greek national newspaper I Kathimerini about “Qu’est-ce Que le Digital Labor?” (1 Nov. 2015)
Ioanna Fotiadi interviewed me for the Greek national newspaper I Kathimerini about our recent book “Qu’est-ce que le digital labor?”… read more Greek national newspaper I Kathimerini about “Qu’est-ce Que le Digital Labor?” (1 Nov. 2015)
New York to San Francisco: my U.S. conference tour (October 20-29, 2015)
If you happen to be in one of these fine US cities, come meet me. I’ll be on a tour… read more New York to San Francisco: my U.S. conference tour (October 20-29, 2015)
Chinese media about “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Oct. 3, 2015)
After a press release by Taiwanese agency CNA, several Chinese-speaking media outlets have been discussing the central theses of our… read more Chinese media about “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Oct. 3, 2015)
Troll studies: resources on trolling, vandalism, incivility online [updated Sept. 2015]
This is part of my ongoing research in the field of troll studies. Follow the hashtag #trollstudies on Twitter, or… read more Troll studies: resources on trolling, vandalism, incivility online [updated Sept. 2015]
Bye bye, La Grande Table
Le vendredi 19 juillet 2013, Caroline Broué a accueilli une délégation des chroniqueurs de La Grande Table pour un dernier… read more Bye bye, La Grande Table
Qu’est-ce que le Digital Labor ? [Audio + slides + biblio]
UPDATE : Qu’est-ce que le digital labor ? est désormais un ouvrage, paru aux Editions de l’INA en 2015. Dans cet… read more Qu’est-ce que le Digital Labor ? [Audio + slides + biblio]
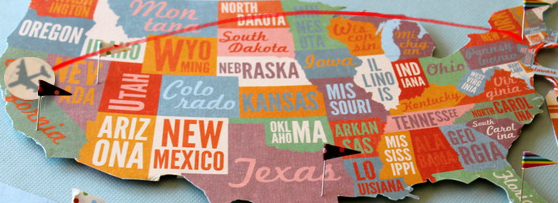

![Troll studies: resources on trolling, vandalism, incivility online [updated Sept. 2015]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2014/07/1302873052100.jpg)
