Tag: le monde

Does the World Really Have 435 Million Online Gig Workers? (Le Monde, Sept. 15, 2023)
The World Bank recently released a comprehensive report titled “Working Without Borders: Promise and Peril of Online Gig Work,” describing… read more Does the World Really Have 435 Million Online Gig Workers? (Le Monde, Sept. 15, 2023)

How Digital Technologies Transformed Human Interactions (in Le Monde, Aug. 7, 2023)
In an article published by French newspaper ‘Le Monde’ titled “Les relations amicales à l’ère des réseaux sociaux” (Friendships in… read more How Digital Technologies Transformed Human Interactions (in Le Monde, Aug. 7, 2023)

Interview dans Le Monde (21 nov. 2021)
A l’occasion de la parution d’un dossier sur le travail des plateformes, j’ai accordé un entretien à la journaliste Catherine… read more Interview dans Le Monde (21 nov. 2021)

Tribune : « StopCovid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers » (Le Monde, 25 avr. 2020)
Avec le mathématicien Paul-Olivier Dehaye et l’avocat Jean-Baptiste Soufron, je cosigne cette tribune dans Le Monde contre le projet d’application… read more Tribune : « StopCovid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers » (Le Monde, 25 avr. 2020)

Tribune dans Le Monde (6 févr. 2020)
« L’avènement du dresseur d’intelligences artificielles » Tribune. Face aux inquiétudes autour de l’effacement annoncé du travail humain par une… read more Tribune dans Le Monde (6 févr. 2020)

“Magnifique leçon de lucidité” : une recension de En attendant les robots (Le Monde, 9 janvier 2019)
Après la publication des bonnes feuilles de En attendant les robots (Seuil 2019) le 3 janvier 2019, le 9 janvier… read more “Magnifique leçon de lucidité” : une recension de En attendant les robots (Le Monde, 9 janvier 2019)

Le Monde publie les bonnes feuilles de “En attendant les robots” (3 janv. 2019)
Le jour 3 janvier 2019 Pixels, le supplément numérique du quotidien Le Monde, publie en avant-première des extraits de mon… read more Le Monde publie les bonnes feuilles de “En attendant les robots” (3 janv. 2019)

La vie privée et les travailleurs de la donnée (Le Monde, 22 janv. 2018)
Dans Le Monde du 22 janvier 2018, je publie avec Paola Tubaro une tribune à l’occasion des 40 ans de… read more La vie privée et les travailleurs de la donnée (Le Monde, 22 janv. 2018)
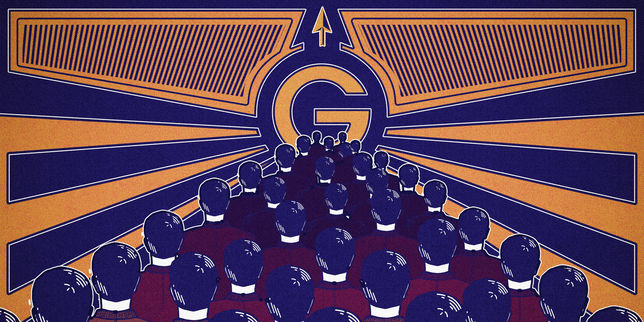
Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)
Le quotidien Le Monde démarre une enquête sur le digital labor. Le coup d’envoi ? Cette interview que j’ai accordée… read more Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)

Dans Le Monde : récension de “Qu’est-ce que le digital labor?” (10 déc. 2015)
Dans le quotidien Le Monde du 10 décembre 2015, David Larousserie nous livre un compte-rendu amusé et amusant de notre… read more Dans Le Monde : récension de “Qu’est-ce que le digital labor?” (10 déc. 2015)