Month: September 2015
La blogosphère à propos de “Qu’est-ce que le digital labor?” (sept.-oct. 2015)
Sur son blog chez Rue89, Antonin Benoit analyse les liens entre micro-travail sur Amazon Mechanical Turk et son ancêtre médiéval, le… read more La blogosphère à propos de “Qu’est-ce que le digital labor?” (sept.-oct. 2015)
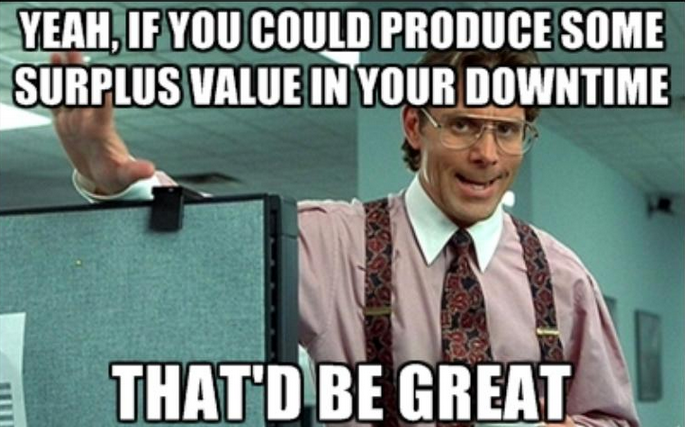
Plateformes numériques et travail : programme du séminaire #ecnEHESS 2015-16
Depuis désormais huit ans, j’assure le séminaire EHESS Etudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques. A l’occasion… read more Plateformes numériques et travail : programme du séminaire #ecnEHESS 2015-16

The ghost of digital labor is haunting Europe (La Repubblica, Italy, 28 Sept. 2015)
“400 million ghosts haunt Europe: they are the users of web platforms, who represent the reserve army of labor in… read more The ghost of digital labor is haunting Europe (La Repubblica, Italy, 28 Sept. 2015)
“Qu’est-ce que le digital labor ?” à la radio (sept. – oct. 2015)
Vertigo, la-1ere, RTS Antonio Casilli interviewé par Magali Philip Lundi, 05 octobre 2015 RCF Lyon Compte rendu de “Qu’est-ce que… read more “Qu’est-ce que le digital labor ?” à la radio (sept. – oct. 2015)
[Slides] Private life and mass surveillance: my conferences mini-tour in Korea
In September 2015, I had the pleasure of spending a week in Seoul having accepted a joint invitation from the… read more [Slides] Private life and mass surveillance: my conferences mini-tour in Korea

Interview on privacy and surveillance (Hankyoreh Shinmun, Korea, Sept. 22, 2015)
After my conference at the Yonsei University, Seoul, I was interviewed by Osung Kwon for the national Korean newspaper Hankyoreh… read more Interview on privacy and surveillance (Hankyoreh Shinmun, Korea, Sept. 22, 2015)

Digital labor et fiscalité du numérique (Corriere della Sera, Italie, 13 sept. 2015)
Il caso Il progetto in Francia «Tassare il web per remunerare chi scrive sui social» Elena Tebano, Corriere della Sera,… read more Digital labor et fiscalité du numérique (Corriere della Sera, Italie, 13 sept. 2015)
Sortie de “Qu’est-ce que le digital labor?” : grand entretien d’Antonio Casilli dans Libération (12 sept. 2015)
Interview Antonio Casilli : «Poster sur Facebook, c’est travailler. Comment nous rémunérer ?» Par Jean-Christophe Féraud Le sociologue développe le concept de… read more Sortie de “Qu’est-ce que le digital labor?” : grand entretien d’Antonio Casilli dans Libération (12 sept. 2015)

Le digital labor et son ancêtre médiéval (Rue89, 11 sept. 2015)
Très intéressant : sur Rue89 Antonin Benoît, jeune chercheur en histoire, analyse les liens entre micro-travail sur Amazon Mechanical Turk… read more Le digital labor et son ancêtre médiéval (Rue89, 11 sept. 2015)
Compte rendu de “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Rue89 – L’Obs, 6 sept. 2015)
Dans le site d’information Rue89, Rémi Noyon dresse un compte rendu synthétique et incisif de Qu’est-ce que le digital labor… read more Compte rendu de “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Rue89 – L’Obs, 6 sept. 2015)


![[Slides] Private life and mass surveillance: my conferences mini-tour in Korea](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/09/511_Privacy-in-the-digital-age.main-visual.jpg)