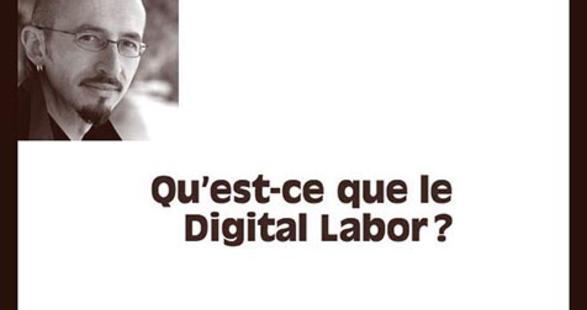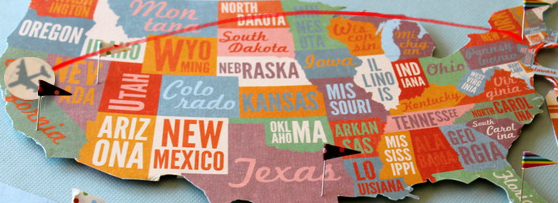Month: October 2015

L’Obs (grand entretien, 24 oct. 2015)
Dans l’Obs, je parle de digital labor avec Amandine Schmitt. Facebook, Twitter : et si nous étions payés pour… read more L’Obs (grand entretien, 24 oct. 2015)
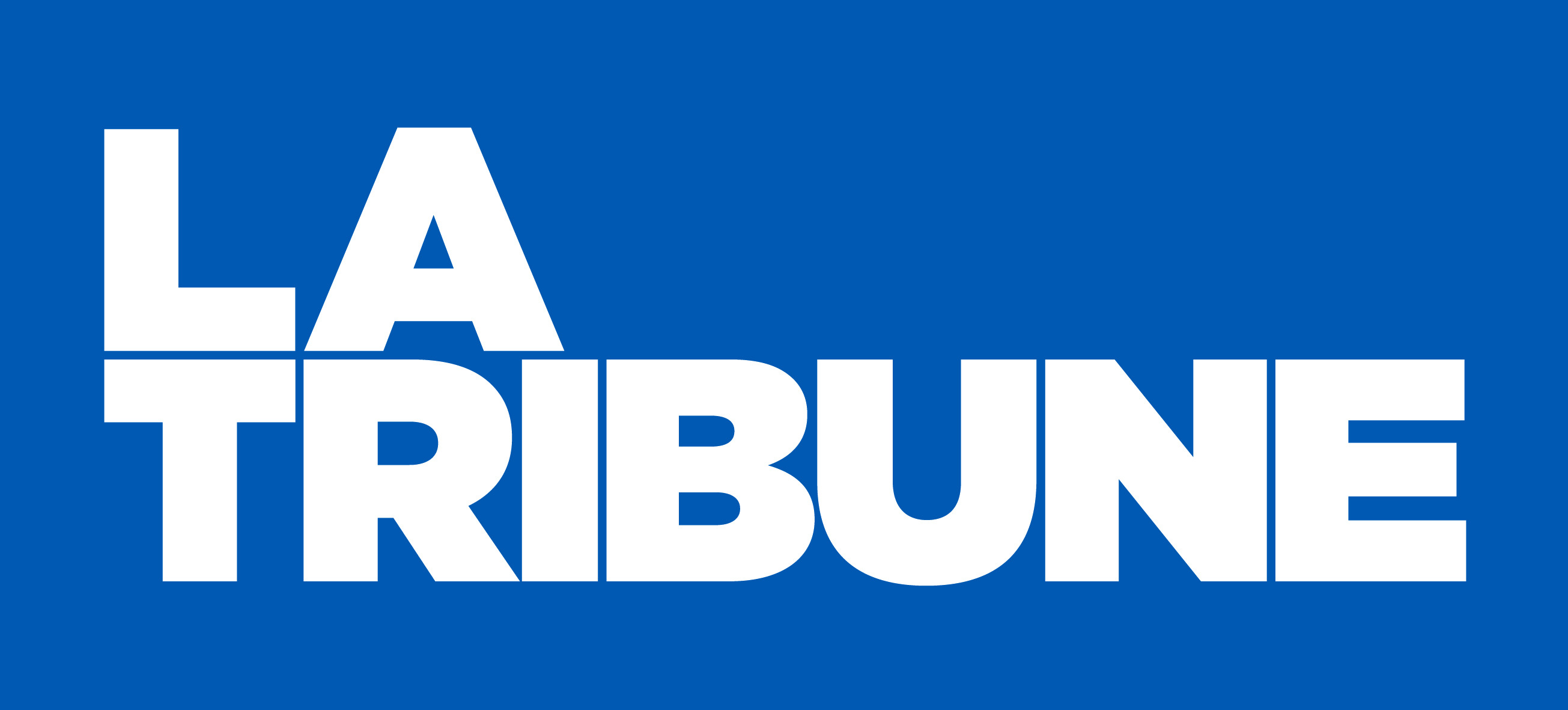
Dans La Tribune (23 oct. 2015)
Dans La Tribune du vendredi 23 octobre 2015, le journaliste Pierre Manière interviewe Antonio Casilli. TAXER LES DATA DES GÉANTS… read more Dans La Tribune (23 oct. 2015)

Grand entretien dans L’Echo (Belgique, 17 oct. 2015)
Dans le quotidien belge L’Echo, une interview à partir de notre dernier ouvrage Qu’est-ce que le digital labor ? (INA,… read more Grand entretien dans L’Echo (Belgique, 17 oct. 2015)
[Radio] ¿Qué es el Digital Labor? (RFI, 16 oct. 2015)
Radio RFI International interviewed me about the latest book I co-authored Qu’est-ce que le digital labor ? (INA, 2015) –… read more [Radio] ¿Qué es el Digital Labor? (RFI, 16 oct. 2015)
[Video] Understanding Digital Labor: An Emerging Sphere of Social Conflicts – Antonio Casilli (Télécom ParisTech / EHESS)
Video of my one-hour lecture Understanding Digital Labor: An Emerging Sphere of Social Conflict, Total Mobilization Conference, Collège d’études mondiales… read more [Video] Understanding Digital Labor: An Emerging Sphere of Social Conflicts – Antonio Casilli (Télécom ParisTech / EHESS)
![[Slides] Séminaire EHESS “Digital labor et capitalisme numérique” (A. Casilli et S. Broca, 2 nov. 2015)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/10/5822675610_b017500d0b.jpg)
[Slides] Séminaire EHESS “Digital labor et capitalisme numérique” (A. Casilli et S. Broca, 2 nov. 2015)
Voilà les slides de la première séance 2015/16 de mon séminaire EHESS Étudier les cultures du numérique : approches théoriques… read more [Slides] Séminaire EHESS “Digital labor et capitalisme numérique” (A. Casilli et S. Broca, 2 nov. 2015)
Interview sur L’Atelier (13 oct. 2015)
Entretien réalisé dans le cadre de l’émission radio “L’Atelier numérique”, sur BFMBusiness. Source: Antonio Casilli : “L’internaute est un travailleur… read more Interview sur L’Atelier (13 oct. 2015)
Grand entretien : Antonio A. Casilli sur Radio VL (11 oct. 2015)
Emission spéciale avec Antonio A. Casilli qui est venu nous parler de son livre tiré d’une conférence avec Dominique Cardon intitulé : “Qu’est… read more Grand entretien : Antonio A. Casilli sur Radio VL (11 oct. 2015)
New York to San Francisco: my U.S. conference tour (October 20-29, 2015)
If you happen to be in one of these fine US cities, come meet me. I’ll be on a tour… read more New York to San Francisco: my U.S. conference tour (October 20-29, 2015)
Chinese media about “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Oct. 3, 2015)
After a press release by Taiwanese agency CNA, several Chinese-speaking media outlets have been discussing the central theses of our… read more Chinese media about “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Oct. 3, 2015)
![[Radio] ¿Qué es el Digital Labor? (RFI, 16 oct. 2015)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/10/logo-rfi-haute-def.jpg)
![[Video] Understanding Digital Labor: An Emerging Sphere of Social Conflicts – Antonio Casilli (Télécom ParisTech / EHESS)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/02/antonio.casilli.png)