Month: February 2019
[Podcast] Interview in OECD’s ‘The Technofile’ [Feb. 28, 2019]
On the occasion of my presentation of the DiPLab project at the OECD ELS seminar, I was interviewed by Clara… read more [Podcast] Interview in OECD’s ‘The Technofile’ [Feb. 28, 2019]

Intervista ne Il Manifesto (27 febbraio 2019)
Nel quotidiano Il Manifesto, una intervista con il giornalista e filosofo Roberto Ciccarelli. Antonio Casilli: «Gli operai del clic sono… read more Intervista ne Il Manifesto (27 febbraio 2019)
[Vidéo] Invité de La Grande Table (France Culture, 26 févr. 2019)
Le 26 février 2019, j’étais l’invité de la deuxième partie de La Grande Table, le magazine culturel de France Culture…. read more [Vidéo] Invité de La Grande Table (France Culture, 26 févr. 2019)

Compte-rendu dans Le Temps (Suisse, 22 févr. 2019)
Le quotidien genevois Le Temps publie une recension de mon ouvrage En Attendant les Robots (Ed. du Seuil, 2019). L’intelligence… read more Compte-rendu dans Le Temps (Suisse, 22 févr. 2019)
[Podcast] Sur Radio-Canada, à l’occasion de la sortie de “En attendant les robots” [Canada, 18 févr. 2019]
A l’occasion de la sortie de En Attendant les Robots (Seuil, 2019) au Canada, la radio québecoise m’a interviewé. Derrière… read more [Podcast] Sur Radio-Canada, à l’occasion de la sortie de “En attendant les robots” [Canada, 18 févr. 2019]

Intervista per La Lettura (Il Corriere della Sera, 17 febbr. 2019)
Nell’inserto culturale del Corriere della Sera di domenica 17 febbraio 2019, Stefano Montefiori mi intervista a proposito del mio libro… read more Intervista per La Lettura (Il Corriere della Sera, 17 febbr. 2019)
[Podcast] L’un de mes livres préférés (France Culture, 16 févr. 2019)
Dans le cadre de l’émission Les Matins du Samedi, j’étais l’invité de Natacha Triou pour son ségment L’Idée Culture. Chaque… read more [Podcast] L’un de mes livres préférés (France Culture, 16 févr. 2019)

Grande interview sur les communs numériques (Le Monde, 14 févr. 2019)
Dans le quotidien Le Monde, j’ai accordé une interview au journaliste Frédéric Joignot. « L’essor des technologies numériques a encouragé un… read more Grande interview sur les communs numériques (Le Monde, 14 févr. 2019)
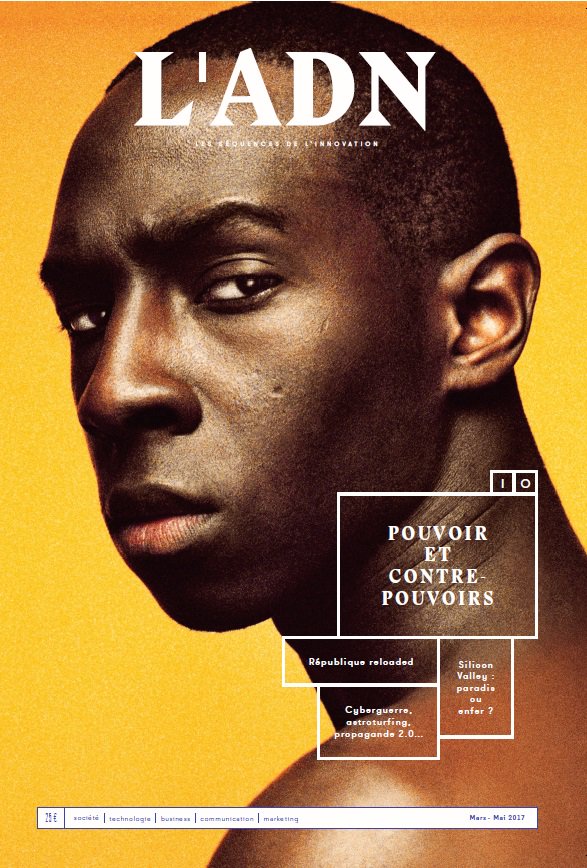
Dans l’ADN (14 févr. 2019)
Dans le magazine L’ADN, David-Julien Rahmil passe en revue les lessons learned de mon ouvrage En attendant les robots (Seuil,… read more Dans l’ADN (14 févr. 2019)

Sur Les Jours (12-28 févr. 2019)
Sur magazine en ligne Les Jours Sophian Fanen lance une nouvelle série d’enquêtes intitulée Working Class Robot. Le premier épisode… read more Sur Les Jours (12-28 févr. 2019)
![[Podcast] Interview in OECD’s ‘The Technofile’ [Feb. 28, 2019]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2019/03/OECD.jpg)
![[Vidéo] Invité de La Grande Table (France Culture, 26 févr. 2019)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2015/11/France_Culture_logo_2005.svg_.png)
![[Podcast] Sur Radio-Canada, à l’occasion de la sortie de “En attendant les robots” [Canada, 18 févr. 2019]](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2016/07/radiocanada.jpg)