Tag: travail
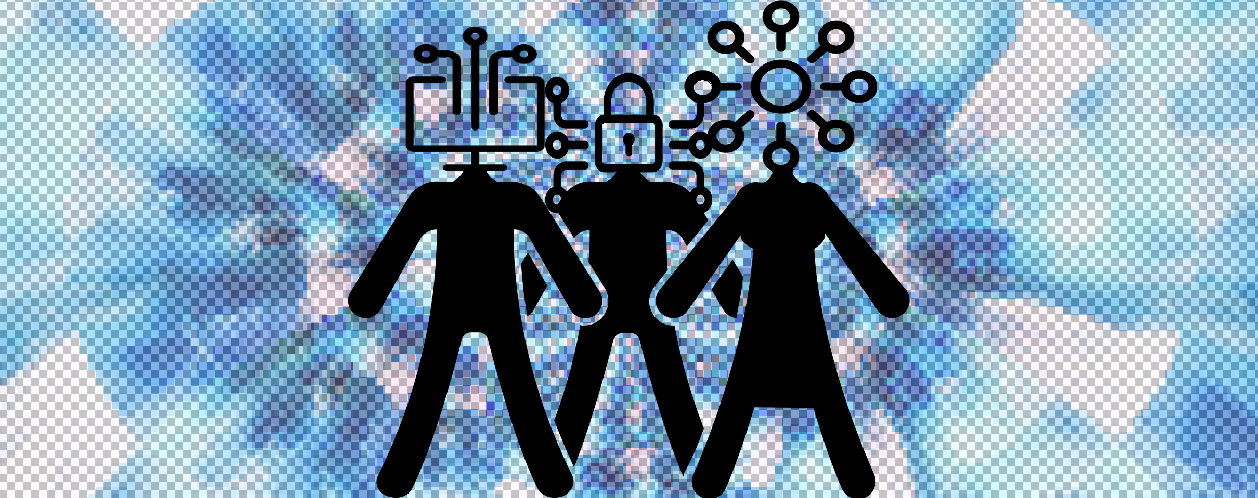
Le programme du séminaire #ecnEHESS 2018/19 est arrivé !
Mon séminaire Étudier les cultures du numérique (mieux connu comme #ecnEHESS) est de retour pour la 11e année consécutive. Structure… read more Le programme du séminaire #ecnEHESS 2018/19 est arrivé !

La déconnexion selon les GAFAM : une stratégie de distraction (Le Figaro, 11 mai 2018)
Dans Le Figaro, Elisa Braun se penche sur les nouvelles fonctionnalités introduites par Google pour aider les utilisateurs Android à… read more La déconnexion selon les GAFAM : une stratégie de distraction (Le Figaro, 11 mai 2018)
![[Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/11/clickfarm.png)
[Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)
Enseignement ouvert aux auditeurs libres. Pour s’inscrire, merci de renseigner le formulaire. Pour la première séance de l’édition 2017/18 de… read more [Séminaire #ecnEHESS] Antonio Casilli : Intelligences artificielles et travail des plateformes (13 nov. 2017)

Pagina99 (Italie, 16 juin 2017)
Nel quotidiano Pagina99, numero speciale del weekend 17 giugno 2017 “algoritmi e sorveglianza”, una lunga intervista rilasciata al giornalista Samuele… read more Pagina99 (Italie, 16 juin 2017)

Linkiesta (Italie, 2 juin 2017)
La giornalista Lidia Baratta pubblica sul sito di informazione Linkiesta una sintesi dettagliata del mio intervento al Jobless Society Forum… read more Linkiesta (Italie, 2 juin 2017)

Corriere della Sera (Italie, 29 mai 2017)
Ne La Nuvola del Lavoro, inserto online del Corriere della Sera consacrato alle evoluzioni dell’economia e dell’impiego, un resoconto dettagliato… read more Corriere della Sera (Italie, 29 mai 2017)

Marché du travail : entre automation et modèles pré-capitalistes (Alternatives Economiques, 28 mars 2017)
Dans le magazine Alternatives Economiques, Franck Aggeri, professeur de management à Mines ParisTech, fournit une analyse en quatre temps de… read more Marché du travail : entre automation et modèles pré-capitalistes (Alternatives Economiques, 28 mars 2017)

Le micro-travail : des corvées peu gratifiantes et mal rémunérées (01net, 22 mars 2017)
Dans le magazine 01net du 22 mars 2017, une longue enquête sur les marchés du micro-travail du Sud Global, avec… read more Le micro-travail : des corvées peu gratifiantes et mal rémunérées (01net, 22 mars 2017)
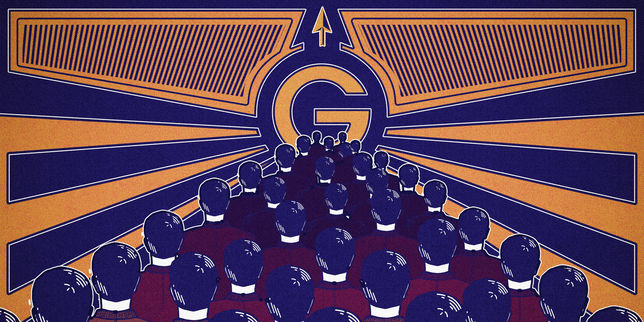
Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)
Le quotidien Le Monde démarre une enquête sur le digital labor. Le coup d’envoi ? Cette interview que j’ai accordée… read more Digital labor, privilège et invisibilisation de la pénibilité (grand entretien dans Le Monde, 11 mars 2017)
![[Vidéo] Intervention au Sénat sur micro-travail, intelligence artificielle et revenu de base (8 févr. 2017)](https://www.casilli.fr/wp-content/uploads/2017/06/Senat_Republique_fr.png)
[Vidéo] Intervention au Sénat sur micro-travail, intelligence artificielle et revenu de base (8 févr. 2017)
J’ai assuré une intervention dans le cadre d’un colloque organisé par le groupe écologiste du Sénat. 1TR_04_REVBA_AntonioCasilli par EcoloSenat